Fact-checking : qui doit vérifier l'information ?
Face à la recrudescence des fausses informations qui pullulent sur les réseaux sociaux, des journalistes spécialisés traquent ces fake news. Les chercheurs et les enseignants participent également à la lutte contre la désinformation.
Depuis dix ans, la chasse aux « infox »1 est devenue une mission à part entière pour les grands médias. Et pour cause : les fausses nouvelles virales pullulent sur les réseaux sociaux. Dans une étude publiée en février 2019, Alexandre Bovet, chercheur à l’Université catholique de Louvain, a ainsi démontré que, lors de la campagne présidentielle américaine de 2016, un quart des tweets contenant un lien vers un article en ligne dirigeait en fait vers des contenus de désinformation2.
Face à l’ampleur du phénomène, les grands médias créent des services internes dédiés à la réfutation d’infox, tels que « Les Décodeurs » du Monde, « CheckNews » de Libération, « Les Observateurs » de France 24, « AFP Factuel » de l’Agence France Presse et « Fake off » de 20 Minutes. D’autres journaux – papier et télévisés – ont intégré le « débunkage de fake news » à la palette des formats journalistiques dont ils disposent pour rendre compte de l’actualité et la mettre en perspective. Cette pratique fait désormais l’objet d’un enseignement dédié dans les écoles de journalisme, en formation initiale ou continue, et il est pratiqué dans les rédactions dans le respect de la Charte d’éthique professionnelle des journalistes 3.
Connu et respecté dans la profession, ce code d’honneur stipule notamment que le journaliste « défend la liberté d’expression et d’opinion », qu’il « n’use pas de la liberté de la presse dans une intention intéressée », qu’il « exerce la plus grande vigilance avant de diffuser des informations d’où qu’elles viennent », qu’il « tient l’esprit critique, la véracité, l’exactitude, l’intégrité, l’équité, l’impartialité, pour piliers de l’action journalistique », et enfin « qu’il tient l’accusation sans preuve, l’intention de nuire, l’altération des documents, la déformation des faits, le détournement d’images, le mensonge, la manipulation, la censure et l’autocensure, la non vérification des faits, pour les plus graves dérives professionnelles ».
Des méthodes de fact-checking fiables, transparentes et non partisanes sont également diffusées aux professionnels par l’IFCN Poynter4, qui recense également les bonnes pratiques à l’international.
Un travail pour des professionnels
Les professionnels de ces cellules d’investigation s’appliquent à répondre à toutes les questions des internautes, sans sélection éditoriale préalable par la rédaction (mais parfois après un vote des internautes) : tous types de sujets peuvent ainsi être décortiqués factuellement en synthétisant les événements, les données et les déclarations-clés, et ce avec la plus grande objectivité possible – c’est-à-dire sans commentaire d’opinion.
L’expertise de ces rédactions dédiées est mobilisée par les géants du numérique (tels que Google ou Facebook) qui sont régulièrement accusés de ne rien faire pour endiguer la propagation des infox en ligne. Dès 2017, Facebook a noué des partenariats pour l’aider à identifier les fausses nouvelles propagées sur le réseau social : en 2018 quelques 52 médias de fact-checking de 33 pays différents l’épaulaient dans ce projet.
Les journalistes scrutent les contenus signalés par les internautes et examinent la cause du signalement : une erreur factuelle, une photo d’illustration prêtant à confusion car prise lors d’un autre événement que celui mentionné dans l’article, un titre trop accrocheur qui ne reflète pas le contenu de l’article, voire des argumentaires délibérément manipulatoires et des pseudo-reportages vidéo fabriqués de toute pièce. Les auteurs des contenus fallacieux sont avertis du retrait de leur texte, et la visibilité des sites qui reçoivent de nombreuses missives de ce type est automatiquement réduite par l’algorithme de Facebook.
Les rédactions reçoivent une rémunération pour leur contribution : Checknews (Libération) a ainsi déclaré publiquement avoir perçu 100.000 euros en 2017 et 245.000 euros en 2018 pour son aide sur la plateforme, tandis que le PDG de l’AFP avait annoncé 1 million d’euros par an pour le périmètre originel du contrat – très étendu depuis.
Un business de profiteurs
Dans le climat actuel de méfiance – voire de défiance - envers les grands médias, ces liens pécuniers ont paru suspects à certains internautes, et les « trolls » cherchant à éroder la confiance des citoyens dans les médias de référence en ont profité pour démontrer un prétendu asservissement de ces rédactions aux géants américains du numérique.
La diffusion de fake news a une dimension stratégique pour les tentatives de déstabilisation politiques entre États, tout comme elle peut aussi s’avérer être une activité très lucrative pour tout individu équipé d’un simple ordinateur connecté : feu-l’auteur américain Paul Horner assurait ainsi en 2016 que l’engouement des internautes pour la lecture de ces fausses nouvelles diffusées sur Facebook lui rapportait « environ 10.000 dollars par mois en revenus publicitaires ». Selon BuzzFeed News, les quatre adolescents macédoniens qui avaient lancé la fausse rumeur sur de prétendus emails de Hillary Clinton, alors candidate à la présidentielle américaine de 2016, auraient gagné 5000 dollars par mois.
Face aux milliers de « trolls » motivés par l’appât d’un gain facile, les équipes de professionnels du fact-checking ne comptent que cinq à quinze journalistes. Certaines agences de fact-checking partenaires de Facebook ont déjà jeté l’éponge, débordées par l’ampleur de la tâche et par la virulence de ces prêcheurs de contre-vérités. Selon Whitney Phillips5, chercheure en ethnographie et folkloriste des médias numériques à l’Institut Data & Society, la réfutation des infox par les grands médias décuplerait l’exposition des contenus biaisés et des thèses complotistes sur les réseaux, et donc leur propagation dans la société. En outre, le fact-checking réduirait peu les croyances dans les fausses informations : selon des chercheurs de Yale, le message d’alerte « mis en question par des fact-checkers indépendants » sur un post Facebook ne diminue que de 3,7 points le crédit de confiance accordé à une infox6.
Une mission pour les professeurs des écoles et les chercheurs
L’émergence de nouvelles technologies, telle que l’intelligence artificielle, ouvre de nouvelles perspectives aux diffuseurs de propagande et d’infox grâce aux « deep fakes » qui permettent de créer une vidéo simulant le discours d’une personnalité grâce aux techniques d’animation de l’image. L’agence américaine de recherche pour la défense (DARPA) a fait appel à des chercheurs pour développer un moyen d’identifier les vrais et les faux visages de ces vidéos trompeuses. L’enjeu est de taille : l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire sur les manipulations de l’information estime que « les tentatives de manipulation de l’information peuvent jouer, de façon insidieuse, sur les divisions sociales et politiques que connaissent nos démocraties ».
Eviter un tel délitement de la société implique la participation active de tous les citoyens à la lutte contre les infox. Pour éviter de les partager, il faut d’abord apprendre à les reconnaître. Quels que soient les progrès technologiques à venir, l’esprit critique des internautes restera le meilleur rempart contre les tentatives de manipulation par la désinformation.
Pour armer les futurs citoyens aux nouvelles formes d’infox qui ne manqueront pas d’apparaître dans les prochaines années, les enseignants sont donc en première ligne. L’Education Nationale s’est déjà emparée de cette mission de sensibilisation, dès les bancs de l’école primaire et jusqu’au lycée, en s’appuyant sur les ressources du Ministère, les outils du Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information (Clemi) ou encore sur la méthode de Rose-Marie Farinella. Pour sensibiliser l’ensemble de la population, il faudrait sans doute que les Universités du Temps Libre rejoignent cette lutte contre les infox : les seniors de plus de 65 ans sont en effet les principaux propagateurs de fake news sur les réseaux sociaux, où ils partageraient en moyenne 7 fois plus de contenus fallacieux que les jeunes de 18 à 29 ans7.
1 Traduction du terme « fake news » officialisée par la Commission d’enrichissement de la langue française (CELF), composée d’experts et membres de l’Académie française, en octobre 2018.
2 Parmi les 171 millions de tweets analysés durant les cinq derniers mois avant le jour de l’élection, 30 millions de tweets – envoyés par 2,2 millions d’internautes - contenaient un lien dirigeant vers un article en ligne. 7,5 millions de ces tweets (soit 25%) menaient vers un article factuellement biaisé.
3 Lire la Charte d’éthique professionnelle des journalistes (rédigée en 1918 et modifiée en 1938 puis 2011) sur le site du Syndicat National des Journalistes : https://www.snj.fr/content/charte-d’éthique-professionnelle-des-journalistes.
4 International Fact-checking Network (IFCN Poynter) https://www.poynter.org/channels/fact-checking/
5 Phillips Whitney, The Oxygen of Amplification : Better Practices for Reporting on extremists, antagonists and manipulators, Data & Society, février 2018
6 Selon les chercheurs de Yale, 14,8% des 5000 Américains exposés à une publication sur Facebook affichant l’avertissement « mis en question par des fact-checkers indépendants » demeurent convaincus de sa véracité, alors que la même publication sans alerte était jugée crédible par 18,5% du panel.
7 Etude menée aux Etats-Unis en 2016 par des chercheurs des Universités de New York et de Princeton, publiée en janvier 2019.
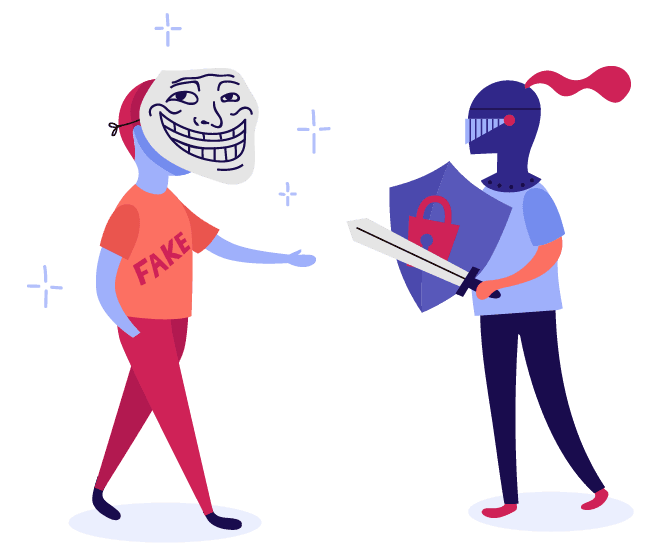
Des robots au service du grand âge
La robotique offre des solutions pour améliorer le quotidien des seniors au grand âge et pour épauler les soignants qui les accompagnent.
Il n’est plus rare de croiser un robot dans une maison de retraite. Des expérimentations sont désormais initiées dans chaque région.
Pionnière en France dès 2015, la ville d’Issy-les-Moulineaux envoie le robot humanoïde Nao (mis au point par une entreprise française rachetée par le japonais Softbank) en mission au sein de ses établissements pour personnes âgées
A l’EHPAD Lasserre, Nao est devenu la coqueluche des pensionnaires, à qui il dispense ponctuellement des cours de sport adaptés au grand âge : du haut de son demi-mètre, le robot parlant fait la démonstration des mouvements à effectuer, et rythme l’exercice en respectant les instructions qu’il a collectées au préalable auprès du responsable d’animation.
Le robot n’intervient jamais seul : trois professionnels – le responsable d’animation de l’établissement, une psychologue et un technicien en robotique - encadrent cet atelier sportif, qui mobilise une seule personne lorsqu’il est dirigé par un humain.
Les séances animées par le robot font salle comble, et les participants se montrent alors particulièrement appliqués. Pour certains seniors au grand âge, il est en effet plus facile de recevoir des consignes de la part d’un robot que d’un homme qui pourrait être leur petit-fils. D’autres se réjouissent d’interagir avec une technologie de pointe, novatrice et internationale, et se sentent ainsi « dans le coup ».
Cette génération découvre les progrès de la robotique émerveillée : une machine qui parle, qui danse et qui « regarde » ses interlocuteurs avec de grands yeux colorés a quelque chose de magique. Le robot ne génère aucune réminiscence chez cette classe d’âge, peu sensibilisée aux craintes actuelles liées à l’essor de la robotique (concernant les éventuelles destructions massives d’emplois par exemple).
Des machines magiques, voire câlines
Si le fabricant de jouets américain Hasbro et le japonais Sega commercialisent auprès du grand public des robots-compagnons qui prennent la forme d’un chat, d’un chien, d’un hamster ou encore d’un perroquet, les constructeurs de robots destinés aux maisons de retraites préfèrent donner à leurs machines intelligentes une apparence qui ne risque pas d’évoquer chez la personne âgée le souvenir - parfois douloureux - d’un animal de compagnie.
Ainsi, le robot-peluche Paro, imaginé en 2005 pour les malades d’Alzheimer par le Japonais Takanori Shibata, a pris les traits d’un phoque. Arrivé en France en 2012, il vise à stimuler les réactions empathiques de l’utilisateur : sa fourrure soyeuse apporte bien-être et décontraction, il manifeste sa joie et s’étire de plaisir quand on le caresse, et il gémit et pleure si on lui tire les moustaches.
Les ergothérapeutes (i.e. : professionnels paramédicaux experts des technologies adaptées aux personnes âgées) valident en général l’utilisation de ces robots par les personnes souffrant d’Alzheimer (même si chaque situation doit faire l’objet d’une recommandation spécifique) : celles-ci apprécient la douceur et l’échange non-verbal - comme avec un animal – tout en se préservant d’un risque de blessure : en effet, elles oublient parfois que tirer les poils d’un animal suscite une douleur… les exposant alors à une réaction de défense, griffure ou morsure.
Des projets actuellement en développement offriront à l’avenir des solutions d’accompagnement des seniors plus variées. Par exemple, la start-up parisienne Wandercraft met au point un exosquelette pour rendre leur liberté de mouvement aux personnes à mobilité réduite, qui permettra aux seniors de se déplacer sans canne, ou de porter des objets sans douleur. Il pourra également faciliter la toilette d’une personne alitée : grâce à cet outil robotisé qui décuple la force des bras, un soignant sera capable d’officier seul sans effort, et sans avoir à solliciter l’aide d’autres intervenants. De quoi soulager les professionnels dans les maisons de retraites, où le manque de personnel est criant, comme celui des aidants à domicile.
A l’avenir, des robots-aidants au quotidien ?
Vivre chez soi le plus longtemps possible - le premier souhait exprimé par les seniors dans l’ensemble des études et sondages réalisés ces dernières années – deviendra possible au grand âge grâce à une nouvelle génération de robots.
Parmi eux, le robot-majordome Leenby, conçu par la société Cybedroid basée à Limoges, est capable de faire la conversation à la personne âgée, de lui rappeler l’heure de prise de ses médicaments, de l’aider à se relever après une chute, et de prévenir les secours si besoin.
La technologie est au point, mais l’entreprise s’interdit de le commercialiser aux seniors du fait de l’absence de cadre réglementaire concernant l’utilisation des robots : les responsabilités respectives du constructeur et de l’utilisateur n’étant pas encore définies par la loi, les sociétés d’assurance ne sont pas en mesure de couvrir le risque d’accident.
En attendant que le législateur se penche sur cette question, d’autres solutions sont d’ores-et-déjà expérimentées.
Ainsi, à Calais, la start-up Unaide accompagne actuellement le retour à domicile de seniors en grande perte d’autonomie qui étaient jusqu’alors hébergés en établissement, grâce à son assistant intelligent. Bardé de capteurs, il écoute les bruits du domicile en permanence pour détecter une situation anormale : dans ce cas, il échange avec le senior pour vérifier si tout va bien, et il prévient le soignant référent à proximité si l’alerte n’est pas levée. Les données collectées sont sécurisées en étant stockées au domicile de l’utilisateur.
Quelle que soit leur forme, ces robots contribueront à améliorer l’accompagnement des seniors ayant besoin de soutien voire de soins (qui seront 1,6 million en France en 2030 et 2,45 millions en 2060) aux côtés des hommes et des femmes qui les aident au quotidien.
Face à la nécessité de repenser le financement cet accompagnement, le président de la République Emmanuel Macron souhaite le vote d’une réforme d’ici à la fin de l’année. Les robots ouvrant des pistes pour réduire le coût de prise en charge de la perte d’autonomie, tant pour les bénéficiaires que pour les finances publiques, qui couvrent 80% du montant total.
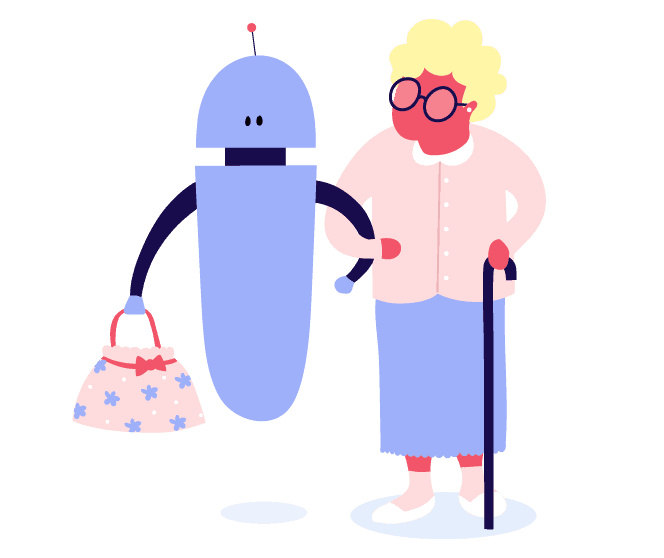
Des applications au secours des consomm'acteurs
Des dizaines d’applications mobiles aident le consommateur à transformer son achat en un acte d’engagement citoyen en faveur de la qualité de l’alimentation ou de la préservation de l’environnement. Mais tous ces guides ne se valent pas.
A l’heure où la défense de l’environnement mobilise en masse au niveau mondial, de nombreux outils numériques aident les consommateurs citoyens à agir. Les réseaux sociaux permettent de dénoncer publiquement les produits de mauvaise qualité, mais aussi de s’informer en consultant des études scientifiques, indépendantes et fiables, et de prendre connaissance des appels à l’action des militants pour la planète de tous âges, comme celui de l’adolescente Suédoise Greta Thunberg1 qui a initié la Grève mondiale pour le climat2.
Les plateformes numériques permettent de populariser rapidement des pétitions en ligne, certaines récoltant plus de 2 millions de signatures en seulement trois semaines3. Quant aux applications mobiles, elles accompagnent les consommateurs désireux d’acheter « responsable » jusque dans les rayons des supermarchés. Ces applications-guides agrègent des bases d’informations pour aider le consomm’acteur à donner une dimension militante et politique à son acte d’achat.
Bien sûr, les citoyens n’ont pas attendu l’essor des technologies digitales pour protester et agir contre les entreprises qui fabriquaient des produits de mauvaise qualité ou qui n’assuraient pas des conditions de travail acceptables. Malheureusement, le boycott économique était un moyen de pression efficace au siècle dernier.
Désormais, « dire non ne suffit plus », affirme la journaliste et militante américaine Naomi Klein4 qui analyse depuis deux décennies l’action citoyenne face aux puissances économiques (entreprises et états). Selon elle, le modèle économique actuel - qu’elle qualifie de « capitalisme débridé » - ne permet pas d’assurer un avenir durable au niveau mondial, et il ne pourra être transformé que grâce à l’engagement des citoyens, et à leur action continue et volontaire.
Un simple scan pour s’informer sur des centaines de milliers de produits
Les applications mobiles destinées à aider le consommateur à mieux s’informer sur les produits et privilégier des achats responsables ont commencé à apparaître en nombre dès 2015. Les plus populaires référençaient les produits « Made in France » ou encore les fruits et légumes de saisons. Mais la plupart des applications mobiles d’aide à la consommation proposaient alors surtout d’identifier le meilleur tarif parmi différentes enseignes de commerçants.
Aujourd’hui, les attentes de consommateurs ont changé, et les applications mobiles se sont perfectionnées : elles proposent désormais d’accéder à une mine d’informations sur la composition d’un produit, sa provenance, ou encore sa valeur nutritionnelle, simplement en scannant son code-barre grâce à l’appareil photo de son smartphone.
Par exemple, Yuka, l’une des applications les plus téléchargées sur l’App Store d’Apple en 2018, renseigne l’acheteur sur 500 000 produits alimentaires et cosmétiques. Le scan du code-barre d’un paquet de biscuit ou d’une bouteille de shampoing fait apparaître sur l’écran du smartphone un avis global sur le produit, formulé en un mot (bon, médiocre ou mauvais) et une couleur (vert, orange ou rouge). Chacun peut ainsi se faire en quelques clics son opinion sur un produit avant de l’acheter.
Pour connaître les justifications de ce verdict, le consommateur peut consulter une fiche détaillée du produit qui mentionne et quantifie ses points forts – notamment ses différents apports nutritionnels - et alerte sur ses points faibles voire ses dangers – comme la quantité d’additifs indésirables. Pour les cosmétiques, les composants chimiques aux noms cryptiques sont accompagnés d’un code couleur précisant leur niveau de toxicité potentiel : il est ainsi plus aisé de faire son choix entre deux produits, quand l’un contient du « propylparabène » (rouge : risque élevé) et l’autre du « méthylparabène » (jaune : risque faible).
L’application QuelCosmétique fonctionne sur le même principe, et permet d’afficher uniquement les produits sans risque, par catégorie (gel douche, crèmes pour le visage, etc.). Open Food Facts mentionne des informations supplémentaires, telles que le pays d’origine des ingrédients et les labels attribués au produit. Parmi les dizaines d’autres applications guides à la consommation disponibles, certaines sont plus spécialisées : dédiées aux produits sans gluten par exemple, ou aux aliments vegans (i.e. : sans aucun composant d’origine animale), ou encore à l’authenticité de l’appellation d’origine contrôlée (AOP) mentionnée sur une bouteille de vin.
Des sources d’information faillibles
Les sources d’information sont hétérogènes et ne sont pas toutes de même qualité. Les unes sont éditées par des organisations non gouvernementales ou à but non lucratif : c’est le cas notamment de QuelCosmétique, piloté par l’association UFC-Que Choisir et d’Open Food Facts, gérée par un collectif de citoyens et ouvert à toute contribution collaborative.
D’autres sont alimentées par des institutions publiques, comme Nutri-Score, conçu par Santé Publique France sous la houlette de la direction générale de la Santé à partir des travaux du chercheur Serge Hercberg, et des études de l’Anses et du Haut Conseil de Santé Publique. Enfin, ces applications-guides peuvent aussi émaner d’entreprises privées spécialisées dans le numérique, et financièrement indépendantes des fabricants des produits qu’elles évaluent : parmi elles, Yuka permet à chaque consommateur de contribuer à sa base de données. Toutes ces applications apportent une information fiable et indépendante.
La fiabilité de l’évaluation est moins certaine quand les applications sont financées par les fabricants de produits eux-mêmes, et ce d’autant plus lorsque la marque qui finance cette application reste masquée. C’est le cas de Num-Alim, un projet soutenu par l’Association nationale des industries alimentaires5. Présentée en novembre dernier, cette base de données en cours de développement ambitionne de compiler les informations nutritionnelles et l’origine géographique des produits, mais aussi les habitudes alimentaires des Français, et de devenir une interface de dialogue entre les agriculteurs et les industriels. « Il ne faut pas que ça serve d’alibi aux industriels pour omettre des informations utiles aux consommateurs sur les paquets des produits comme le système Nutri-score », a d’ores et déjà alerté le chercheur Serge Hercberg.
Enfin, toutes les applications-guides n’ont pas le même coût pour l’utilisateur. Certaines sont payantes (achat de l’application elle-même, et/ou abonnement pour consulter la base de données) mais la majorité d’entre elles sont gratuites. A une nuance près : celles qui exigent la création d’un compte utilisateur compilent et utilisent vos données. Le guide de consommation qu’elles offrent est gratuit, mais c’est alors vous le produit.
1 Voir son discours à la COP 21, en décembre 2018 : https://www.youtube.com/watch?v=Bypt4H8K5dI
2 Le vendredi 15 mars 2019, les lycéens du monde entier ont séché les cours pour manifester pour la défense de la planète. Selon Fridaysforfuture.org, plus de 2 000 rassemblements ont été organisés dans le monde, dont 212 en France.
3 Intitulée « l’affaire du siècle », la pétition mise en ligne par quatre ONG (Greenpeace, la Fondation pour la nature et l’Homme (FNH), Oxfam et l’association Notre affaire à tous) le 18 décembre propose d’attaquer l’Etat en justice pour « inaction climatique ». Elle est à ce jour en France la pétition qui a reçu le plus grand nombre de soutiens, avec 2,17 millions de signataires en mars 2019.
4 Auteur de No Logo (2001), elle développe cette thèse dans Tout peut changer (octobre 2016) et Dire non ne suffit plus (novembre 2017).
5 L’Ania regroupe des industriels de toutes tailles, des TME aux grands groupes.
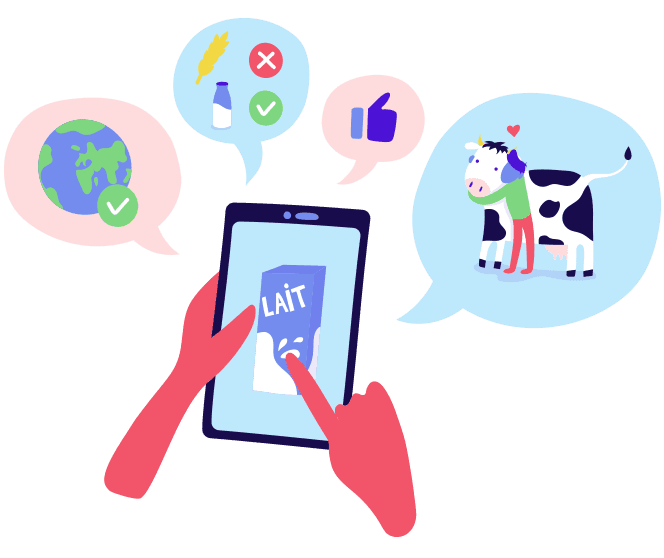
Numérique et démocratie : les liaisons dangereuses ?
Le numérique peut encourager les plus jeunes à voter et favoriser l’implication des citoyens dans les décisions politiques. Mais il est aussi un outil de prédilection pour les manipulateurs d’opinion.
A l’instar de Tinder, une application propose à chacun de trouver l’élu… parmi les candidats au Parlement européen.
Lors des dernières élections européennes1, l’association Vote&Vous a co-construit avec 15 partis européens un quiz interactif d’information sur leurs programmes abordant des sujets variés : le réchauffement climatique, l’immigration, le mariage homosexuel, le libéralisme économique, l’interdiction du glyphosate, programme Erasmus, taxation des GAFA, référendum européen, égalités salariales homme-femme ou encore le salaire minimum dans l’Union européenne.
Le citoyen connecté se prononçait en accord ou non avec les propositions présentées, puis hiérarchisait celles qu’il avait retenues, et l’application lui indiquait le candidat idéal. Dans le même but, les dix items du questionnaire à choix multiples WeEuropeans conçu par l’association Make.org proposaient aux internautes d’identifier le bulletin à glisser dans l’urne, et cela en moins de dix minutes.
D’autres plateformes numériques ont fleuri sur la Toile peu avant le scrutin pour en présenter les enjeux de façon ludique, telles que Citizen’s app - mise au point par le Parlement européen - ou encore PopEurope. Celle-ci a été imaginée par la Maison de l’Europe pour sensibiliser les primo-votants et les inciter à prendre part au débat démocratique.
En effet, les trois-quarts des citoyens de moins de 35 ans n’avaient pas exercé leur droit de vote lors des élections européennes de 2014.
De même, en 2017 en France, les jeunes de 18 à 29 ans - bien que très majoritairement inscrits sur les listes électorales (85%) - avaient boudé les urnes : selon l’Insee, seuls deux sur dix avaient participé à tous les tours de la présidentielle et des législatives, contre 35% de l’ensemble des électeurs. Or, en mai dernier, la participation record des jeunes a déjoué les prévisions des sondeurs : 40% des électeurs de moins de 35 ans ont voté (avec un taux de participation globale en hausse, à 51,5%) selon Ipsos.
Les applications, podcasts et autres outils numériques d’information sur le débat démocratique en Europe ont donc sans doute atteint leur objectif, même si cette participation record des jeunes – qui a profité en premier lieu à la liste Europe Ecologie Les Verts2 - s’inscrit dans une mobilisation plus large en faveur de la défense de l’environnement et du climat.
Au-delà des élections, des outils pour co-construire les règles de vie de la cité
Le numérique facilite en effet la constitution de groupes d’influence citoyens et l’organisation d’actions comme les rassemblements et les pétitions. Il offre également un espace d’échange et de proximité avec les élus, qui l’utilisent pour soutenir les actions citoyennes locales IRL3.
Ainsi, le Conseil régional Centre-Val-de-Loire a instauré le Printemps citoyen : réunis sur une plateforme numérique ouverte aux propositions des associations locales, cette initiative dédiée au débat démocratique sur des sujets de société a compté cette année 71 événements sur le territoire régional qui ont réuni 4 200 personnes.
Le numérique permet aussi d’impliquer les citoyens dans la création de nouveaux services publics : la Région Bretagne a ainsi initié en avril dernier un datathon ouvert à tous et un incubateur dédié à l’expérimentation de nouvelles propositions de services publics par des start-ups locales.
De même, au niveau national, le gouvernement a lancé plusieurs consultations depuis un an pour recueillir les propositions des citoyens : sur l’accompagnement des seniors au grand âge dans le cadre d’une réforme de la santé, ou encore sur la démocratie, le pouvoir d’achat et la transition écologique dans le cadre du Grand Débat.
Ces consultations ambitionnent de nourrir la décision politique grâce au principe d’intelligence collective : conçues par l’ensemble de la société, les mesures seraient plus représentatives des idées de tous, plus consensuelles, plus justes aux yeux de chacun, mieux adaptées à la réalité du quotidien, et donc plus efficientes.
L’espace démocratique en ligne n’échappe pas aux tentatives de manipulation
Depuis son origine, Internet poursuit l’ambition de permettre un espace ouvert à tous, inclusif, libre et partagé. Les réseaux sociaux se veulent des espaces de débat permanents et collectifs, capables de favoriser la construction démocratique. Mais cet idéal rencontre des obstacles dans les faits, à commencer par les difficultés d’accès à l’outil numérique.
En effet, selon le Credoc, l’illectronisme concernerait 13 millions de Français soit 20 % de la population4. Les espaces numériques dédiés au débat démocratique excluraient donc de fait un citoyen sur cinq.
Par ailleurs, les réseaux sociaux, envisagés d’abord comme des plateformes de construction d’idées et de propositions grâce au dialogue argumenté entre le plus grand nombre d’internautes, ont été envahis par le pugilat et la propagande.
Le système de recommandation de contenus en vigueur sur les réseaux sociaux, qui repose sur la suggestion par les algorithmes de contenus similaires à ceux déjà consultés, empêche l’internaute de découvrir et d’explorer des propositions différentes de ses opinions déjà formées, et l’enferme dans une vision étriquée qui tend alors à se radicaliser au fil du temps.
De plus, le pseudonymat en vigueur sur ces plateformes - qui est garant de la liberté d’expression des minorités – facilite la diffusion des idées militantes dans le but d’orienter les convictions des citoyens en période électorale.
Le chercheur indépendant Baptiste Robert, qui tweete sous le pseudonyme « Elliot Alderson », a ainsi montré dans une enquête publiée par Mediapart en avril dernier, que les partis politiques français ont eu recours aux faux comptes sur les réseaux sociaux pour populariser leurs programmes en amont des élections européennes.
Lors de l’élection présidentielle aux Etats-Unis en 2016, le scandale Cambridge Analytica a montré que les réseaux sociaux pouvaient même devenir l’instrument de diffusion de « fake news » au bénéfice d’un candidat.
Former les citoyens de demain grâce à l’éducation aux médias numériques
Si rien de tel n’a été observé en France jusqu’à présent, les récents progrès des technologies numériques décuplent les risques de manipulation : l’intelligence artificielle permet aujourd’hui de créer de toutes pièces un discours vidéo semblant authentique, tel que celui mettant en scène l’ancien président américain Barack Obama insultant son successeur Donald Trump5.
A court terme, les campagnes électorales risquent d’être parasitées par ces « deep fake ». Les citoyens qui y seront confrontés sont aujourd’hui sur les bancs des écoles (voire des collèges ?). L’Education nationale est en première ligne pour les former à développer leur esprit critique face aux contenus diffusés par les plateformes numériques, où les frontières du savoir et de l’imposture sont de plus en plus floues.
1 Du 23 au 26 mai 2019 en Europe (le 26 en France)
2 En France, la liste EELV est arrivée troisième. Elle ressort en tête chez les jeunes, réunissant 28% des suffrages exprimés chez les jeunes de 25 à 34 ans et 25% chez les jeunes de 18 à 24 ans selon Ipsos.
3 In real life (dans l’environnement physique, par opposition à la sphère numérique)
4 https://www.mesdatasetmoi-observatoire.fr/article/illectronisme-une-fracture-sociale-ineffacable
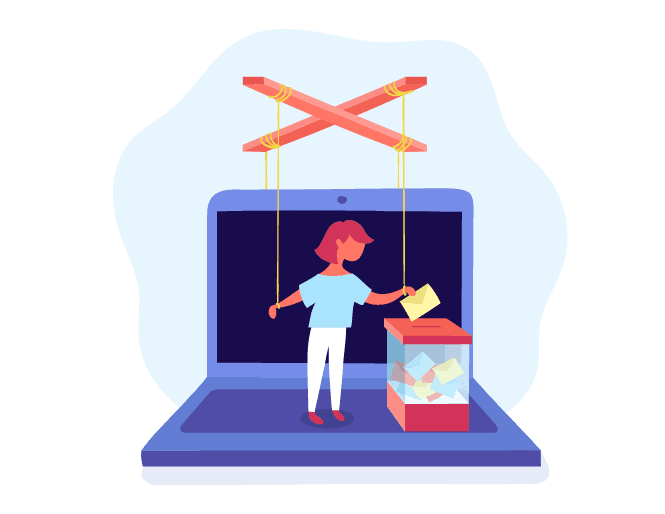
Faceapp, test ADN : à quoi consent-on pour s'amuser ?
Les applications récréatives sur les réseaux sociaux et les analyses d’ADN exigent la divulgation des données biométriques, les plus personnelles qui soient.
L’été est propice aux activités récréatives et beaucoup d’utilisateurs ont choisi cette période pour découvrir les traits de leurs visages vieillis de quelques années en téléchargeant l’application mobile Faceapp, ou encore pour parcourir les secrets de leur ADN dévoilés par une entreprise spécialisée moyennant quelques dizaines d’euros. La curiosité que suscitent ces expériences suffit à donner envie de se prêter au jeu, dont on pressent d’emblée qu’il aura de quoi engendrer un fou rire, des rêveries voire des discussions passionnées sous les parasols.
Leurs conditions d’utilisation - rédigées sous une forme juridique des plus rébarbatives, on les accepte machinalement sans les lire : notre consentement est de toute façon nécessaire pour accéder à ces services divertissants. Et c’est ainsi que l’on abandonne tous droits sur nos données personnelles les plus intimes et les plus précieuses qui soient : nos données biométriques. Par définition, celles-ci nous collent à la peau pour la vie : on peut changer d’identité, mais pas d’ADN, ni de visage (sauf en ayant à recours à des opérations de chirurgie esthétique lourdes et coûteuses). Les entreprises qui proposent ce type d’applications et de tests ludiques ne cachent pas qu’elles collectent, conservent et commercialisent ces données, sans toutefois préciser à qui et dans quel but.
Les conditions d’utilisation de l’application Faceapp mentionnent explicitement que l’internaute cède tous ses droits sur la photo qu’il transmet pour servir de support au filtre de vieillissement par intelligence artificielle, et que la photo et l’image créée seront conservées pendant 48h et pourront être vendues à des tiers à toutes fins, notamment commerciales. D’autres données – comme le nom de l’utilisateur – sont également recueillies.
Un consentement vraiment libre ?
Malgré ces contraintes, Faceapp revendique plus de 100 millions de téléchargements depuis sa création en 20171, dont 12,7 millions entre le 10 et le 18 juillet dernier, après que des célébrités – comme le rappeur Drake, très populaire chez les jeunes – ont publié les images de leurs visages vieillis sur les réseaux sociaux, où un #AgingChallenge a connu une viralité aussi massive qu’immédiate.
Aux Etats-Unis, le succès de cette application éditée par l’entreprise russe Wireless Lab OOO a alarmé le Parti Démocrate, échaudé par l’affaire Cambridge Analytica2 : il a demandé à ses membres de ne pas utiliser cette application, redoutant une manipulation lors de l’élection présidentielle américaine en 2020. Le sénateur démocrate américain Chuck Schumer a même adressé un courrier au FBI pour solliciter l’ouverture d’une enquête sur les éventuels risques induits pour la sécurité nationale, et à la Commission fédérale du Commerce pour évaluer les garde-fous à mettre en place pour veiller au respect de la vie privée des citoyens américains.
En Europe, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de 2016 protège les internautes contre toute utilisation non souhaitée de leurs données en exigeant des géants du numérique qu’ils recueillent leur consentement. Responsable de l’application du RGPD en France, la Commission nationale Informatique et Libertés (CNIL) souligne que ce consentement doit être recueilli « par un acte positif clair3 par lequel la personne concernée manifeste de façon libre, spécifique, éclairée et univoque son accord ».
Pour autant, cocher une case ou cliquer sur un bouton « j’accepte » ne signifie pas que l’utilisateur a bien pris connaissance de ce qu’il concède, ni qu’il a compris les enjeux que suppose l’envoi d’une simple photo, ou d’un échantillon de salive. De nombreux Français ont ainsi frotté l’intérieur de leur joue avec un coton-tige avant de l’envoyer aux Etats-Unis pour décryptage, sans même savoir que l’analyse d’ADN est interdite en France et qu’ils s’exposent ainsi à une amende de 3750 euros.
Votre don d’ADN est conservé dans des bases de données géantes d’entreprises privées
La promesse de ces tests fait rêver l’utilisateur : les réseaux sociaux véhiculent une légion de vidéos émouvantes montrant la rencontre de cousins qui ne se connaissaient pas, d’enfants abandonnés qui retrouvent leurs parents, ou de suprémacistes blancs qui révisent leurs convictions en apprenant qu’une part de leur génome vient de souche africaine.
Les laboratoires spécialisés dans ces tests (comme AncestryDNA, 23andMe, MyHeritage DNA, HomeDNA, Living DNA, Veritas Genetics…) y trouvent aussi leur compte : outre les frais d’analyse de l’échantillon facturés à l’utilisateur (entre 70 et 100 euros), ils perçoivent des revenus des groupes pharmaceutiques à qui ils revendent ces échantillons conservés dans des bases de données colossales : ainsi, à elle seule, la société MyHeritage détient 92 millions de comptes individuels, répertoriant des données généalogiques et d’ADN.
La plupart des entreprises testeuses d’ADN proposent en effet de déterminer les origines ancestrales des ADN qui leur sont adressés, en détectant des zones géographiques de vie des aïeux lointains ou des éventuelles traces d’ADN de l’homme de Néandertal, voire de déterminer si la personne a des ancêtres juifs. Ce dernier point d’analyse est fourni automatiquement par certaines sociétés, sans que le requêteur en ait fait la demande, ce qui fait débat : du point de vue européen, la religion est une donnée personnelle hautement confidentielle.
Quelques entreprises se penchent en outre sur les risques de maladie marqués sur les gènes testés : c’est à la suite d’une telle analyse, pointant un risque de développement d’un cancer du sein, que l’actrice Angelina Jolie a décidé de pratiquer une masstectomie préventive. Des chercheurs s’inquiètent de la généralisation de ces tests, estimant qu’ils peuvent pousser à des interventions chirurgicales non nécessaires, ou à révéler des origines familiales insoupçonnées pouvant remettre en question l’histoire familiale.
De plus, l’exactitude de ces tests est contestée par de nombreux experts, et par le simple fait qu’un même échantillon testé dans deux laboratoires différents peut générer des conclusions différentes. En conséquence, il est recommandé de discuter le bilan reçu avec un professionnel, en particulier sur les prédictions d’ordre médical.
Un business lucratif qui profite aux laboratoires pharmaceutiques
Les bases de données colossales constituées par les entreprises testeuses d’ADN sont mises à disposition des laboratoires pharmaceutiques pour leur permettre de mieux connaître le potentiel de développement de différentes pathologies au sein de la population, et pour alimenter les recherches sur des maladies comme Parkinson ou Alzheimer. Il est possible de s’opposer à cette utilisation, et les utilisateurs européens, couverts par le RGPD, peuvent également demander la destruction de leur test après analyse et la non-commercialisation des résultats, ce que les laboratoires s’engagent à respecter (sans toutefois fournir de preuve).
Toutefois, la plupart d’utilisateurs de tests ADN (80% des clients de 23andMe par exemple) acceptent sciemment de fournir leur échantillon à des laboratoires dans l’espoir de participer à faire progresser la science. Ils cèdent ainsi tous droits de leurs données biométriques sur la foi d’une promesse, mais sans que l’utilisation exacte qui en sera faite ne soit précisée.
La biométrie est au cœur des nouvelles technologies pour la sécurité
Actuellement, on n’imagine guère à quels risques on s’expose en diffusant notre ADN ou les traits de nos visages. Pourtant, ces données collectées par des entreprises privées peuvent d’ores-et-déjà être utilisées pour exercer des programmes d’intelligence artificielle, notamment des algorithmes de reconnaissance faciale. Ces technologies commencent à donner lieu à des solutions commercialisées pour garantir la sécurité – collective ou individuelle.
Cette année, la Ville de Nice a expérimenté avec succès un programme de reconnaissance faciale pour autoriser ou non l’accès au site du Carnaval avec le concours de 1000 citoyens volontaires. Cette technologie pourrait séduire les 3500 municipalités françaises qui ont installé des dispositifs de vidéosurveillance pour garantir la sécurité de leur espace public. Une telle généralisation est déjà mise en place en Chine, ne manquant pas de soulever des inquiétudes quant aux libertés individuelles face à cette surveillance permanente d’individus identifiables à tout moment dans la rue. La Ville de San Francisco s’en méfie au point d’avoir interdit l’implantation des technologies de reconnaissance faciale sur son territoire.
De nombreux autres usages des données biométriques ne manqueront pas d’apparaître dans les prochaines décennies (avec des solutions de paiement par empreinte digitale par exemple). Un consentement au partage de nos données biométriques accordé aujourd’hui sans réflexion pour se divertir quelques minutes pourrait avoir à l’avenir des conséquences bien moins sympathiques.
1 Faceapp propose également des filtres pour transposer un visage féminin en traits masculins (et vice versa) ou encore pour changer la couleur de peau d’une personne.
2 Le documentaire « The Great Hack » (Netflix) détaille cette affaire qui concerne l’utilisation des données personnelles (convictions politiques) de 87 millions d’Américains collectées sur Facebook afin d’influencer l’élection présidentielle américaine de 2016 au profit de Donald Trump.
3 Le consentement n’est donné que lorsque l’internaute fait une action (telle que cocher une case ou cliquer sur un bouton « j’accepte » par exemple)
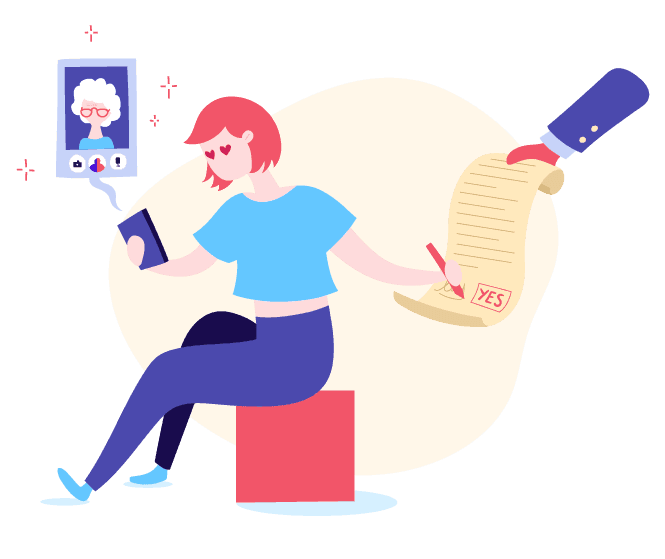
Tous diffuseurs de fake news malgré nous ?
Le fonctionnement des réseaux sociaux et le manque de connaissances contribuent à la propagation des infox.
Qui n’a jamais partagé une fausse nouvelle, par conviction ou en toute bonne foi ?
Les infox font désormais partie du quotidien des internautes, et leur production est devenue une industrie globalisée, aux répercussions massives tant dans la sphère politique qu’économique.
Ce sont des fake news qui ont permis d’influencer l’élection présidentielle aux Etats-Unis en 2016 (scandale Cambridge Analytica). En 2013, c’est une rumeur prétendant que Barack Obama – alors président des Etats-Unis - avait été blessé dans une explosion qui avait fait chuter les cours de bourse à Wall Street, entraînant une perte de valeur de 130 milliards de dollars en quelques minutes.
Au-delà des instigateurs d’infox, qui cherchent sciemment à opérer une manipulation de masse pour servir leurs intérêts parfois avec l’aide d’entreprises spécialisées dans l’influence en ligne, certains diffusent des fake news pour gagner leur vie. C’est le cas pour une cohorte de travailleurs du clic. Ils sont les rouages indispensables de la propagation d’infox, et sont rémunérés seulement quelques dollars – une fortune pour les résidents des pays émergents.
Selon le chercheur Antonio Casilli 1, des plateformes de création et de diffusion de contenus, telles que Fiverr, permettent ainsi de produire une campagne de désinformation à grande échelle à partir de 5 dollars. Selon lui, d’autres plateformes d’aide aux entreprises, comme Amazon Mechanical Turk créée en 2006, qui rémunèrent la participation des internautes entre 1 et 15 cents pour répondre à un sondage en ligne par exemple, contribuent également à la circulation des fake news.
La surreprésentation des fake news sur les réseaux sociaux est due aux partages humains
Les infox pullulent sur Internet, et notamment sur les réseaux sociaux. Dans une étude publiée en 2018, des chercheurs américains du Massachusetts Institute of Technology (MIT) 2 ont recensé 126 000 propagations de rumeurs et fausses informations 3 en langue anglaise sur Twitter entre 2006 et 2017, impliquant 3 millions de personnes et plus de 4,5 millions de partages.
Selon eux, les fausses nouvelles - à propos de la politique, de légendes urbaines ou de la science - sont plus virales et se répandent plus largement et plus vite que les informations authentiques : « Alors que la vérité est rarement diffusée à plus de 1 000 personnes, le 1 % des principales fake news est régulièrement diffusé auprès de 1 000 à 100 000 personnes. (…) La vérité met six fois plus de temps que la rumeur à atteindre 1 500 personnes. »
Des faux comptes sur les réseaux sociaux et des « bots » sont utilisés pour propager ces fakes news. Mais selon eux, les technologies d’automatisation du partage de contenus propagent autant de fake news que d’informations véridiques : ce sont donc les actions humaines qui accélèrent la diffusion des infox, et non les robots. Ainsi, du fait des posts des internautes de chair et d’os, une fake news a 70 % de chances de plus qu’une vérité d’être partagée en ligne.
Originalité et émotions : les ressorts de la viralité des infox
La viralité des infox tient d’abord à leur caractère original : la nouveauté attire l’attention humaine 4, comme l’ont montré les chercheurs en informatique de l’Université de Californie du Sud (USC) Laurent Itti et Pierre Baldi, car elle implique un changement de notre représentation du monde, et par conséquent elle est moteur d’action.
Elle nous apparaît comme utile et a donc intérêt à être partagée. Mais au-delà du caractère novateur – puisque créé de toutes pièces – de l’infox, la viralité des fake news s’explique également par les émotions qu’elles suscitent : le dégoût, la peur et la surprise 5.
La réaction émotionnelle est en effet inhérente au fonctionnement des réseaux sociaux : pour participer à la conversation globale, il faut répondre rapidement, c’est-à-dire « à chaud », sans recul. L’émotion prend alors le pas sur le raisonnement.
A l’heure de l’apologie de la réactivité et de la promptitude à commenter, on en arrive même à partager des contenus qu’on n’a pas lus : 59 % des liens partagés ne sont jamais cliqués, autrement dit les internautes qui les partagent n’ont consulté que le titre du contenu, selon une étude menée par l’INRIA et l’Université de Columbia 6.
La fiabilité perçue d’un contenu dépend de qui nous le recommande
Or, l’effet de recommandation est puissant : une étude aux Etats-Unis publiée en 2017 7 a montré qu’un contenu partagé sur les réseaux sociaux par un ami nous apparaît comme étant plus fiable que le même contenu partagé par une personne inconnue, mais également comme vecteur d’informations plus digne d’intérêt et de re-partage.
Ainsi, un même contenu diffusé sur Facebook – par exemple un article publié par l’agence de presse Associated Press – a été jugé fiable par 52 % des répondants à l’enquête lorsque le lien a été partagé par une personne de confiance, mais par 32 % seulement lorsque le lien a été partagé par une personne dont ils se méfient, alors que la source de l’information – identique dans les deux cas – était mentionnée.
L’éducation aux médias comme solution à la désinformation, à tout âge
Dès lors, la culture et les croyances de celui qui partage jouent un rôle important dans le type d’informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Or, les fausses convictions sont fréquentes : un Français sur cinq adhère en effet à au moins cinq théories du complot, selon un sondage réalisé en décembre 2018 8.
Cette vulnérabilité face aux thèses complotistes décroît avec le niveau de diplôme, mais également avec l’âge : elle touche 28 % des jeunes, mais seulement 9 % des plus de 65 ans. Pour autant, les digital natives partagent moins d’infox que les « digital immigrants » : les internautes de plus de 65 ans partagent en moyenne 7 fois plus d’infox que les plus jeunes, selon une étude américaine sur la propagation de fake news sur Facebook en période électorale 9.
Une des hypothèses avancées pour expliquer ce constat est que les aînés ne connaissent pas toujours les codes des réseaux sociaux et peuvent ainsi considérer des parodies de façon littérale : en effet, les articles humoristiques diffusés par des sites dédiés à la dérision (Le Gorafi ou NordPresse par exemple) adoptent les mêmes chartes graphiques que les médias traditionnels. Or, les seniors sont de plus en plus nombreux à rejoindre les réseaux sociaux, et ils s’y montrent plus actifs que la moyenne.
L’essor des fake news pourrait ainsi perdurer. Pour endiguer la désinformation massive, l’éducation aux médias et aux réseaux sociaux apparaît donc comme une priorité, et ce à tout âge !
1 http://www.casilli.fr/tag/fake-news/
2 VOSOUGHI Soroush, ROY Deb, ARAL Sinan, The spread of true and false news online, Science n°359, mars 2018 : https://www.americanvoiceforfreedom.org/wp-content/uploads/2018/03/The-spread-of-true-and-false-news-online.pdf
3 L’identification comme infox a été réalisée par six plateformes de vérifications de faits : snopes.com, politifact.com, factcheck.org, truthor-fiction.com, hoax-slayer.com, and urbanlegends.about.com
4 ITTI Laurent, BALDI P, Bayesian surprise attracts human attention, Vision Res n°49, 2009.
5 VOSOUGHI Soroush, ROY Deb, ARAL Sinan, The spread of true and false news online, Science n°359, mars 2018.
6 GABIELKOV Maksym, RAMACHANDRAN Arthi, CHAINTREAU Augustin, LEGOUT Arnaud, « Social Clicks : what and who gets read on Twitter ? », INRIA, juillet 2016.
7 « Who shared it ? How Americans decide what news to trust on social media », menée par Media Insight Project à l’initiative de l’American Press Institute, mars 2017.
8 Enquête réalisée par l’Ifop pour la Fondation Jean-Jaurès et Conspiracy Watch à propos de l’accident de Lady Diana, les vaccins, les Illuminatis, les « chem trails » ou encore la mission Apollo sur la Lune.
9 GUESS Andrew, NAGLER Jonathan, TUCKER Joshua, Less than you think : prevalence and predictors of fake news dissemination on Facebook, Science Advances vol. 5 n°1, janvier 2019.

24 heures dans la vie d'une famille connectée
Les Français passent un tiers de leur journée connectés à Internet. En fonction des âges, les usages et les équipements utilisés varient. Suivez le quotidien de trois membres fictifs d’une famille représentative de nos habitudes en ligne.
6h30, presque un tiers d’une journée. C’est le temps que les Français passent en moyenne chaque jour sur Internet. En plus d’établir ce chiffre, le premier Baromètre digital BNP Paribas-CSA Research, publié en novembre dernier, a cherché à comprendre comment nous surfons, sur quels sites et pour quels usages. Pour illustrer les conclusions de ce baromètre, nous avons imaginé une famille représentative des pratiques connectées en France, constituée de trois membres : Léa, l’adolescente hyperconnectée, son père Christophe, qui utilise Internet pour le travail autant que pour sa vie personnelle, et sa grand-mère Nicole. Voici le récit-fiction de leur journée.
Smartphone en main dès le réveil
7h00. Le réveil sonne. Léa, 17 ans, ouvre un œil et attrape son smartphone. Pas question de se lever avant de s’être connectée sur Facebook. 84% de ses amis sont inscrits sur ce réseau social, qui est l’application la plus utilisée par les mobinautes de tous âges. Comme 8 jeunes âgés de plus de 15 ans sur 10, autant dire tout le monde au lycée, elle ne peut pas envisager d’aller en cours sans avoir son smartphone dans la poche, et pour cause : c’est lui qu’elle utilisera principalement pour se connecter à Internet dans la journée. Pendant au moins 4 heures.
Avant de repousser la couette, Léa publie un selfie intitulé « pas envie d’aller en cours » sur Snapchat, le réseau social sur lequel la majorité de ses camarades sont inscrits, mais pas ses parents. Comme elle, 35% de ses camarades ont pris l’habitude de poster des photos d’eux sur les réseaux sociaux. Mais elle ne diffuse pas de clichés montrant ses proches. Seul un quart des jeunes le font.
Son père, Christophe, 47 ans, partage parfois quelques photos sur Facebook, mais c’est très occasionnel. Et comme près de la moitié des mobinautes, il restreint à ses seuls amis l’accès à ses images personnelles. Lui aussi débute sa journée sur son smartphone, mais il l’utilisera moitié moins de temps que sa fille au cours des prochaines 24 heures. Léa est de nouveau connectée, sur Instagram, pour poster une photo de la tenue vestimentaire qu’elle a choisi de porter ce jour-là.
En buvant son café, Christophe consulte une application de transport pour identifier le meilleur trajet pour se rendre à son premier rendez-vous client. Tout en évitant de préciser sa géolocalisation. Avant de se mettre en route, il consulte ses e-mails, usage fréquent pour la moitié des mobinautes, et il efface sans l’ouvrir ce courriel avec pièce jointe venant d’un expéditeur inconnu, pour éviter tout risque de piratage de ses données personnelles. Un coup d’oeil aux sites d’information, et il est temps de partir. Il attrape ses clés de voiture et son ordinateur portable professionnel, qui lui permettra de naviguer en ligne pendant 3 heures dans la journée. Après le déjeuner, de retour au bureau, il se connectera pendant 2h30, sur son ordinateur fixe cette fois, pour réaliser des opérations financières professionnelles. Entre deux dossiers, il consultera sa messagerie personnelle. Puis, comme trois utilisateurs professionnels sur dix, il utilisera Internet pour promouvoir son activité sur la page Facebook de l’entreprise, pour gérer ses déplacements professionnels, pour se tenir informé des meilleures pratiques dans son secteur, et pour stocker des fichiers. Il s’interdit de transférer des documents professionnels sur ses appareils personnels, par sécurité.
La journée au bureau touche à sa fin, et comme 20% des professionnels, Christophe s’accorde un moment au bureau pour traiter quelques affaires personnelles : gérer sa carrière sur LinkedIn, consulter son profil personnel sur Facebook, traiter une demande administrative ou encore faire un achat en ligne. Comme 97% des internautes qui possèdent un smartphone, Christophe est adepte du e-commerce. Il préfère ne pas enregistrer ses données bancaires sur les sites où il effectue ses achats, sauf sur ceux qu’il utilise souvent. Comme ce site de livraison de pizzas, où il passe commande pour le dîner du soir avec sa fille et sa mère, Nicole…
[* “97”, “des internautes qui possèdent un smartphone”, “achètent en ligne”, “” *]
De retour à la maison, il consulte son compte bancaire en ligne. Il fait pleinement confiance à sa banque pour garantir la sécurité de ses données – bancaires comme personnelles- plus encore qu’à son opérateur mobile. Mais il ne le fait pas n’importe où. Puis il se tourne vers sa tablette, qu’il utilise en moyenne 1h30 par jour pour lire les résultats sportifs ou se détendre en jouant à Candy Crush. Le « social gaming » séduit à tout âge ! Pendant ce temps, Léa est rivée à l’ordinateur familial. Comme 8 jeunes de moins de 25 ans sur dix, elle se rue sur Internet pour regarder la télévision et télécharger des films, des livres ou de la musique, ou pour regarder des films en streaming. Mais ce soir-là, elle suit un MOOC pour développer ses connaissances en dehors de l’école sur les sujets de son choix. Un quart de ses camarades sont inscrits à ces cours en ligne gratuits.
Internet n’est pas invité à table, si ce n’est dans la conversation.
La grand-mère, Nicole, estime que les risques sur Internet se sont accrus au cours des dix dernières années, et Léa acquiesce. Christophe, lui, fait partie des 10% de Français qui pensent que la Toile est devenue plus sûre. On parle « anti-virus » (qui oserait surfer sans en avoir un?), « paramètres de confidentialité », « historique de navigation », « géolocalisation » et « cookies ». Personne ne se demande s’il est question du dessert. Ces mots sont connus par 8 à 9 Français sur 10. D’autres restent mystérieux.
Léa explique donc à Nicole le concept du « phishing », le protocole de paiement sécurisé « https », et les avantages du « cloud ». Seuls 35% des Français utilisent cette solution de stockage, plébiscitée par près de la moitié des jeunes. Nicole se demande où sont stockées les photos que l’on poste sur les réseaux sociaux, et personne ne sait exactement. Par une anecdote, chacun raconte avoir pris des risques pour sa sécurité en ligne : Léa reconnaît s’être connectée à des sites inconnus avec ses identifiants Facebook, Nicole avoue utiliser le même mot de passe pour tous les comptes qu’elle crée et Christophe admet qu’il ne lit jamais les conditions d’utilisation avant de les accepter. On se promet d’être plus vigilants en découvrant les chiffres du piratage en ligne : un Français sur six et une entreprise française sur dix en ont été victimes au cours de l’année écoulée. Les trois convives s’accordent sur la nécessité de désactiver un compte victime de piratage. Mais de là à avertir la police… Et personne ne songe à solliciter la Cnil, qui est pourtant l’organisme chargé de protéger les citoyens sur Internet.
Le dîner terminé et Nicole partie, Léa se saisit de la tablette familiale pour acheter en ligne ce flacon de parfum qu’elle a découvert dans le tutoriel vidéo tout juste publié sur Youtube par sa blogueuse préférée, qui a le même âge qu’elle. La soirée touche à sa fin. Christophe récupère la tablette pour visiter quelques sites d’information avant d’éteindre les lumières. Léa est déjà couchée, mais pas déconnectée. Elle a tant de choses à raconter à ses amies par messagerie instantanée avant de s’endormir … avec son smartphone sur l’oreiller.
Sources complémentaires : Médiamétrie, Air of Melty
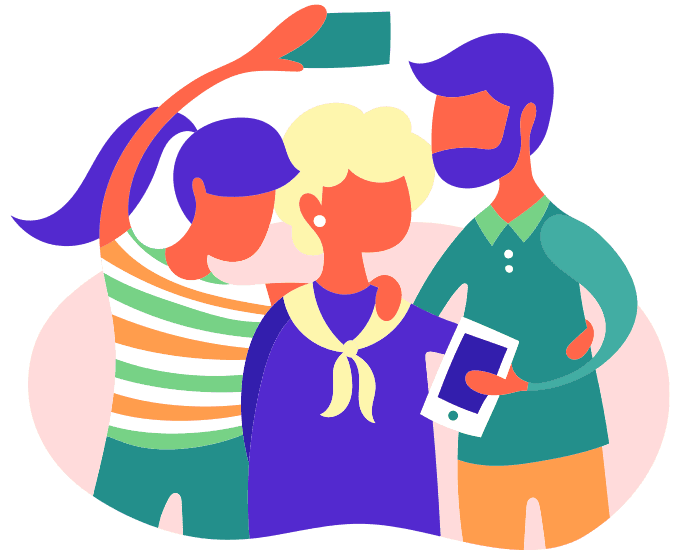
20 milliards d'espions connectés parmi nous
Pour la santé, les économies d’énergies ou le sport, les objets connectés promettent de nous simplifier la vie. Mais ils menacent aussi notre vie privée et notre sécurité en ligne selon les autorités de protection des données de 25 pays, qui tirent la sonnette d’alarme.
Imaginez un réfrigérateur qui commande les courses à notre place pour qu’on ne manque jamais de yaourts ou de jus d’orange. Ou encore, un radiateur qui chauffe davantage à partir du moment où l’on quitte son lieu de travail, pour que la température soit agréable quand on arrive à la maison, tout en ayant fait des économies d’énergie et de budget pendant la journée. Les sportifs, eux, adopteront les bracelets de mesure de l’effort et les maillots capables d’analyser la performance sur le terrain. Quel que soit la préoccupation, particulier ou professionnel, il existe un objet qui peut faciliter la vie, dès lors qu’on le connecte à Internet via un smartphone. Plus de 20 milliards d’objets connectés sont actifs à travers le monde depuis 2015, selon une étude de Cisco. Autrement dit, chaque jour dans le monde, il y a plus d’objets qui se connectent à Internet que de personnes ! Et d’ici à 2020, on devrait compter plus de 50 milliards d’objets connectés dans le monde. Mais l’essor de ces objets destinés à nous aider pose des questions de sécurité et de respect de la vie privée.
Une cible de choix pour les hackers
En mai dernier, un groupe de chercheurs de Microsoft et de l’Université du Michigan a montré de multiples failles de sécurité dans le dispositif de maison connectée de Samsung, SmartThings. Ils avaient alors averti que des hackers pourraient utiliser les vulnérabilités du système pour s’y introduire et prendre le contrôle des serrures connectées ou des détecteurs de fumée. Mais c’est le vendredi 21 octobre 2016 que l’ampleur de la faille de sécurité posée par les objets connectés s’est révélée. Ce jour-là, des pirates ont bloqué l’activité de plusieurs géants du Web, dont Twitter, Airbnb, Netflix, Amazon et Spotify, en lançant une attaque « DDoS », destinée à submerger des sites par de nombreuses demandes de connexion pour les rendre inaccessibles. Pour mener cette opération, ils ont conçu un programme malveillant, Mirai, capable de détourner des millions d’objets connectés de leur fonction pour les transformer en robots-soldats sur la toile. Des simples webcams et même des dispositifs pour surveiller le sommeil des bébés ont ainsi été détournés, selon le New York Times.
La plupart des objets connectés disponibles sur le marché sont peu sécurisés, tant au niveau du matériel que des applications et logiciels pour les activer. Mais au-delà de la sécurisation du réseau se pose l’enjeu de la collecte et de l’utilisation des données personnelles par ces objets. Le GPEN (Réseau mondial pour le respect de la vie privée) qui rassemble les autorités de protection des données de 25 pays, dont les États-Unis et la plupart des pays européens, a tiré la sonnette d’alarme en septembre dernier.
Des passoires à données personnelles
Pendant six mois, les chercheurs du GPEN ont passé au crible plus de 300 objets connectés de différentes marques, pour vérifier auprès des fabricants comment ils assurent le respect de la vie privée des utilisateurs. Leurs conclusions sont sans appel : près de 8 fabricants sur 10 n’ont pas su expliquer comment l’utilisateur pouvait effacer ses données de l’objet connecté ; 7 sur 10 n’ont pas été capables de préciser comment ces données étaient stockées ; 6 sur 10 ne sont pas parvenus à informer les consommateurs de l’utilisation faite de leurs données ; et enfin, 4 sur 10 ne fournissaient pas de contact au consommateur pour lui permettre de poser ses questions en matière de gestion des données.
Les objets connectés sont donc des espions dormants au coeur de notre quotidien. A commencer par les bracelets qui contrôlent notre état de forme et les montres intelligentes, qui sont les objets connectés les plus vendus en France (1,2 million d’exemplaires vendus en 2015, pour un chiffre d’affaires de 220 millions d’euros selon l’Institut GfK). Jour après jour, ils récupèrent des informations sur nos déplacements, notre état de santé, nos préférences alimentaires… Pas de quoi regarder votre balance connectée de travers ? Détrompez-vous ! La collecte des données par les objets connectés ouvre la voie à de nouveaux marchés prometteurs… et qui pèsent lourd !
Un marché à 1200 milliards en 2020
Selon l’institut Gartner, les objets connectés feront économiser 1 milliard de dollars par an aux consommateurs et aux entreprises d’ici à 2022. Selon le cabinet IDC, les entreprises se ruent déjà sur les objets connectés, et ont dépensé 737 milliards de dollars (soit 685 milliards d’euros) en 2016, en croissance de 18% par rapport à 2015. Cette tendance devrait se maintenir, et le marché des objets connectés, pour les entreprises et les particuliers, atteindrait ainsi 1290 milliards de dollars (soit 1200 milliards d’euros) de chiffre d’affaires en 2020. Tous les secteurs sont concernés : du transport à l’énergie, en passant par les assurances. Apple a choisi pour sa part de concentrer ses efforts dans la santé, en s’associant à Watson, l’intelligence artificielle développée par IBM, à qui elle envoie les données de santé collectées sur les utilisateurs d’iWatch, de façon anonyme.
Face à cet engouement, les défenseurs de la vie privée militent pour une régulation rapide. Ils redoutent que nos objets connectés en disent trop et que les collecteurs de données les revendent à qui bon leur semble. Dans leurs pires cauchemars, cette fuite de données pourrait impacter l’attribution ou non d’un prêt, faire flamber le montant d’une police d’assurance ou empêcherait de décrocher un emploi. L’opinion publique se montre sensible à cette question. Lors d’une étude sur « l’état de la maison connectée » menée en 2015 par iControl, une majorité d’Américains se sont déclarés « préoccupés » (27%) ou « très préoccupés » (44%) par le respect de la vie privée dans une maison équipée de domotique.
Mais concrètement, comment contrôler la non-diffusion de chaque donnée dans le volume colossal produit quotidiennement ? La Federal Trade Commission, une agence non gouvernementale américaine, indique ainsi dans son rapport « Internet des objets : respect de la vie privée et sécurité dans un monde connecté » (2015) que 10.000 foyers connectés produisent 150 millions d’éléments de données… chaque jour ! Et l’invasion des objets connectés ne fait que commencer.
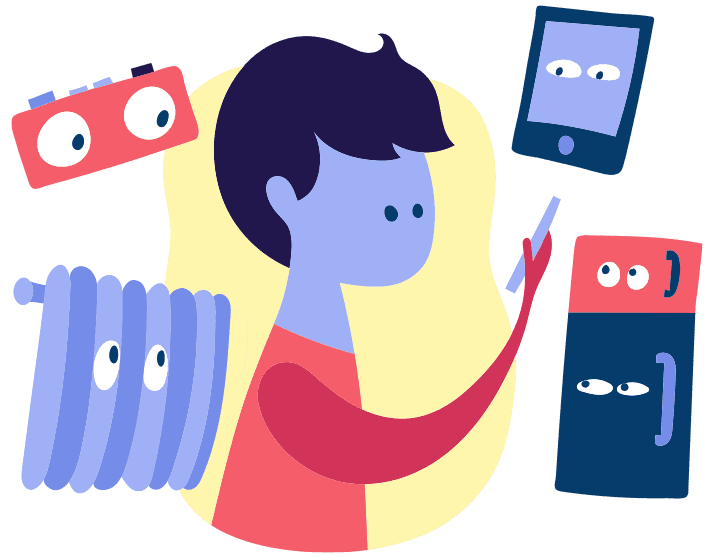
Le coût environnemental du numérique augmente
La part d’énergie mondiale utilisée pour produire des appareils numériques et utiliser des services en ligne a doublé par rapport à 2012 et ne cesse de croître. Des solutions existent pour rendre la croissance numérique plus soutenable.
A l’heure de la transition écologique, le numérique propose des solutions autant qu’il pose des défis. En effet, l’Internet au niveau mondial engloutit actuellement l’équivalent de deux fois la consommation énergétique de la France, soit 1500 térawattheures.
D’après les estimations réalisées par Françoise Berthoud, chercheuse en informatique au CNRS et directrice du groupe de travail « pour une informatique responsable » EcoInfo, le secteur des nouvelles technologies absorberait ainsi 10% de l’électricité mondiale, suivant une consommation croissant de 8% par an, tandis que la consommation d’électricité globale ne progresse que de 3% par an.
Selon elle, ce secteur serait aussi responsable de près de 4% de nos émissions de gaz à effet de serre, soit une part équivalente à celles issues de l’aviation civile en 2013, et qui devrait correspondre aux niveaux d’émission de l’industrie automobile d’ici à 2025.
Le stockage des données dans les data centers, principal poste de consommation énergétique du secteur des nouvelles technologies il y a dix ans, ne mobilise plus qu’un sixième des besoins en énergie. Un rééquilibrage lié aux efforts menés par ces centres de stockage pour réduire leur empreinte carbone, mais aussi à l’augmentation de la consommation d’autres secteurs du numérique.
A titre d’exemple, les réseaux qui transportent les informations numériques sont désormais tout aussi énergivores que les datas centers ; une observation qui s’applique aussi aux équipements individuels (smartphones, tablettes, ordinateurs fixes ou portables) adoptés par un nombre croissant d’utilisateurs.
Mais c’est surtout la fabrication de ces appareils qui est particulièrement gourmande en énergie : en 2017, elle absorbait à elle seule la moitié de la consommation énergétique du secteur du numérique.
Cette étape de la vie d’un appareil concentrerait d’ailleurs les trois quarts de son empreinte environnementale totale - incluant la consommation de toutes les ressources nécessaires à sa production telles que l’eau et les métaux – selon une étude de l’Ademe et France Nature Environnement publiée en septembre 2017.
Les nouvelles technologies sont gourmandes en métaux rares
24 millions de téléphones portables sont vendus en France chaque année depuis 2012, et un foyer français possède en moyenne 2,4 appareils. Or, pour produire un seul smartphone, il faut mobiliser plus de 70 kg de ressources naturelles et jusqu’à 50 métaux différents.
Un smartphone contient par exemple 34 mg d’or, utilisés notamment pour fabriquer sa puce électronique. Dans un rapport d’information remis en septembre 2017, la sénatrice Marie-Christine Blandin souligne qu’il faut 200 grammes d’or pour produire une tonne de cartes électroniques (pesant environ 2 grammes chacune), alors qu’une mine permet d’extraire entre 0,7 et 5 grammes d’or par tonne de roche excavée.
Les nouveaux smartphones achetés chaque année par les Français nécessitent donc l’extraction de 2000 à 14000 tonnes de roches dans les mines pour fournir la quantité d’or nécessaire à leur fabrication. Or « l’exploitation des minerais s’accompagne de conséquences désastreuses pour l’environnement mais aussi pour les populations locales, comme en Chine avec le néodyme ou encore en République Démocratique du Congo avec le tantale et le cobalt », souligne Héloïse Gaborel, chargée de mission à France Nature Environnement.
9 Français sur dix renouvellent leurs appareils alors qu’ils fonctionnent encore
Pour réduire l’impact environnemental des nouvelles technologies, cette association a lancé un appel conjoint avec l’Ademe en faveur d’une consommation plus responsable de nos appareils numériques : 88% des Français changent de téléphone portable tous les deux ans, alors que l’ancien fonctionne encore.
Témoignant lors d’une conférence organisée par France Stratégie en 2018, Laëtitia Vasseur, la co-fondatrice et déléguée générale de l’association Halte à l’obsolescence programmée (HOP), a estimé que « le taux de renouvellement excessif des produits n’est pas soutenable à long terme ». En effet, selon elle, la durée de vie des ordinateurs a été divisée par 3 en 30 ans (passant d’une durée de 11 ans à 4 ans aujourd’hui).
Un cycle de vie raccourci qui touche tous les outils numériques, couplé à une diversification croissante résultant de la généralisation des tablettes et des smartphones. ~~HOP plaide donc pour freiner cette « obsolescence esthétique », encouragée par le marketing, qui pousse à renouveler des équipements encore fonctionnels.
~~Elle milite également pour faire connaître la loi de 2015 qui sanctionne le délit d’obsolescence programmée (technique ou logicielle), et pour établir une réglementation contraignant les fabricants à soumettre leurs appareils à des tests indépendants pour évaluer leur durabilité et leur réparabilité. Ainsi, un indicateur fiable et standardisé pourrait être établi afin de guider le consommateur dans son parcours d’achat responsable.
Moins d’un quart des matériaux d’un smartphone sont recyclés
Selon l’Ademe, 30 millions de téléphones portables obsolètes dorment dans nos tiroirs et seuls 15% des smartphones sont actuellement recyclés. Moins du quart des matériaux qu’ils contiennent peuvent être réutilisés, à cause des alliages subatomiques qui sont réalisés lors de leur fabrication et qui sont ardus à déconstruire. Un meilleur recyclage des appareils implique donc une conception adaptée par le fabricant.
Pour réduire le poids environnemental de la production d’appareils neufs et ralentir l’épuisement des gisements de métaux, l’Ademe encourage les consommateurs à faire réparer leurs anciens appareils et à s’équiper en matériel reconditionné, proposé par des entreprises spécialisées dans cette activité, qui sont de plus en plus nombreuses.
Le numérique pourrait consommer 20% de l’électricité mondiale en 2025
D’ici à 2025, la consommation énergétique des nouvelles technologies pourrait atteindre 20% de la consommation totale au niveau mondial, du fait de l’évolution de nos usages. La popularité du streaming décuple en effet les besoins tant au niveau des réseaux que des appareils individuels : une heure de vidéo regardée en ligne consomme autant d’énergie qu’un réfrigérateur pendant une année entière. 1
L’engouement pour les jeux vidéo en ligne pèse aussi sur les ressources : un personnage virtuel de Second Life consomme autant d’énergie qu’un habitant du Brésil, selon les calculs du journaliste américain Nicholas Carr en 2006.
Le développement des objets connectés (réfrigérateurs, voitures, etc.), qui devraient franchir le cap des 50 milliards d’appareils dès 2020, pourrait renforcer cette tendance. Mais Olivier Berder, professeur à l’IUT de Lannion, à l’Université de Rennes 1 et responsable de l’équipe Granit de l’Irisa, se montre au contraire optimiste : il estime que les objets connectés (IoT) vont apporter des solutions nouvelles pour nous aider à mieux maîtriser nos consommations en électricité et en eau, tout en mobilisant moins d’énergie pour fonctionner qu’un ordinateur de bureau.
La feuille de route pour réduire notre empreinte environnementale liée au numérique serait donc simple : s’équiper en objets connectés, faire réparer ses appareils plutôt que de les remplacer par des neufs… et regarder moins de vidéos de chats mignons.
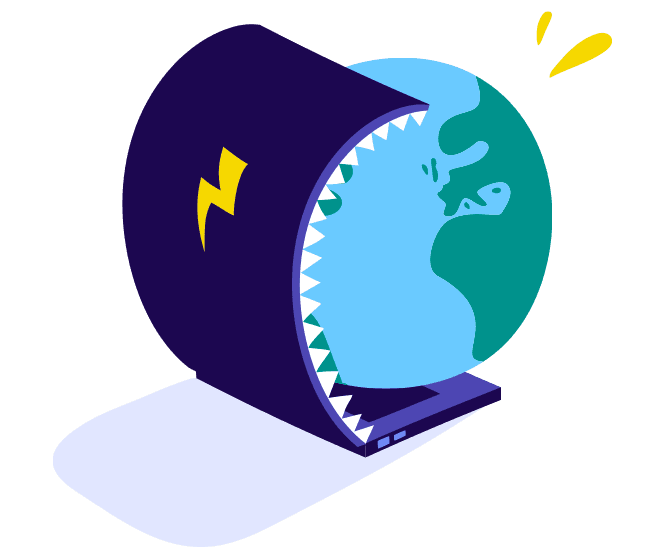
10 films et séries sur l'intelligence artificielle pendant les vacances
Notre sélection d’œuvres filmographiques pour découvrir ou redécouvrir les fantasmes et les avancées autour des androïdes et des algorithmes auto-apprenants pendant les vacances de Noël.
La réalité n’a pas encore (totalement) dépassé la fiction. Voici 10 films et séries pour explorer les problématiques liées à l’intelligence artificielle (IA) :
1 / Metropolis 1 : le classique qui a donné le « la »
Le pitch : Dans une ville futuriste où une classe aisée et oisive domine celle des travailleurs, un robot est utilisé pour prendre la place d’une ouvrière, Maria, et semer la discorde dans la communauté. Il finit brûlé sur un bucher.
Pourquoi le voir : Ce film de 1926 écrit et réalisé par Fritz Lang montre pour la première fois un robot humanoide au cinéma. Cet Androïde métallique aux courbes féminines a posé des bases esthétiques qui inspireront notamment le design de C-3PO dans Star Wars.
2 / 2001, odysée de l’espace 2 : l’IA, l’homme et les étoiles
Le pitch : Suite à la découverte d’un monolithe noir extraterrestre, une équipe d’astronautes part en mission vers Jupiter accompagnée d’une intelligence artificielle réputée infaillible : Hal 9000. Mais l’algorithme pensant doute de la finalité de la mission et… change l’ordre de ses priorités.
Pourquoi le voir : Le robot qui aide l’homme dans la conquête spatiale est un thème récurrent dans les fictions sur l’intelligence artificielle. Il illustre le but initial de la création de la machine pensante : permettre à l’être humain de dépasser ses limites et de réaliser des missions ambitieuses. Ce film de 1968 a été écrit par son réalisateur, l’américain Stanley Kubrick, et le futurologue britannique Arthur Charles Clarke. Pour la première fois, une intelligence artificielle non humanoïde est mise en scène.
Alternative : Interstellar 3 (par Christopher Nolan en 2014), qui présente la même quête spatiale mais qui met en scène une intelligence artificielle bienveillante envers les humains. Dans la saga Star Wars 4, certains robots sont ennemis et d’autres alliés des héros humains. A voir depuis la trilogie initiale (par George Lucas dès 1977) jusqu’à l’épisode 8 (diffusé pour la première fois à Los Angeles le 10 décembre 2017).
3 / Matrix 5 : notre futur dans un siècle ?
Le pitch : Un pirate informatique cherche à libérer l’humanité de l’emprise d’une intelligence artificielle et de ses agents tueurs. Cet algorithme pensant, omnipotent et destructeur veut maintenir les humains dans une illusion de réalité, la Matrice, pour mieux les contrôler.
Pourquoi le voir : La trilogie de Lana et Lilly Wachowski (1999 puis 2003) donne une représentation imagée de ce qu’est un « réseau de neurones » artificiels. Il souligne la puissance d’une machine pensante connectée au réseau. Ce film a été cité comme exemple par le docteur Laurent Alexandre, essayiste spécialiste de l’intelligence artificielle, lors d’une allocution devant le Sénat en janvier 2017 : selon lui, sans régulation politique, « dans un siècle, on a Matrix ».
Alternative : Terminator 2 6 (James Cameron, 1991) représente également un monde rempli de machines tueuses, dirigées par une intelligence artificielle misanthrope appelée Skynet.
4 / Ex Machina 7 : de la conscience chez les robots
Le pitch : Un programmeur informatique est sélectionné par un riche et brillant ingénieur vivant reclus afin de venir tester les capacités de sa dernière création, une Androïde nommée Ava.
Pourquoi le voir : Ce film met en scène une intelligence artificielle forte, c’est-à-dire douée de raisonnement mais aussi d’émotions et de conscience. Il permet également de comprendre ce qu’est le test de Turing, élaboré par l’Anglais Alan Turing en 1950, qui est la référence pour évaluer l’intelligence d’une machine. Ce test a été réussi pour la première fois par un algorithme autoapprenant du Massachusetts Institute of Technology en 2016.
Alternatives : Adapté d’une nouvelle de science-fiction de Philip K. Dick, Blade Runner 8, le film de Ridley Scott sorti en 1982, illustre également le test de Turing. La suite de ce classique, Blade Runner 2049 9, est sortie sur les écrans en France en octobre dernier. Les saisons 3 et 4 de Marvel : Agents of S.H.I.E.L.D. 10 illustrent également l’émergence de la conscience chez une androïde, Aida.
5 / L’Homme bicentenaire 11 : le robot qui voulait devenir humain
Le pitch : Andrew, un robot domestique au service de la famille Martin depuis 200 ans, développe des sentiments et aspire à la liberté.
Pourquoi le voir : Ce film de Chris Colombus datant de 1999 est adapté d’un roman d’Isaac Asimov, qui défend la vision d’un robot intelligent et non menaçant. Il explore la différence entre la machine et l’homme.
Alternative : A.I. : Intelligence artificielle 12 (Steven Spielberg, 2001), dont le héros est un robot en quête de son identité après avoir été abandonné par sa famille adoptive.
6 / Wall-E 13 : l’intelligence artificielle expliquée aux enfants
Le pitch : En 2805, un robot compacteur de déchets est envoyé sur la Terre désertée car polluée. Il apprend les émotions en rencontrant un autre robot EVE, dont il tombe amoureux.
Pourquoi le voir : Ce film de Disney sorti en salles en 2008 illustre la capacité d’apprentissage du robot, voire sa capacité émotionnelle. Capable de reprogrammer son code informatique tout seul, Wall-E est une intelligence artificielle forte, qui ouvrirait l’ère de la singularité technologique (où les robots pourraient s’affranchir des hommes).
Alternative : Chappie 14, le robot qui cherche à s’émanciper après avoir découvert les intentions réelles de sa « famille », un gang sans scrupule.
7 / Real Humans 15 : la question des droits des robots
Le pitch : Dans un monde parallèle, les robots humanoïdes partagent le quotidien des humains : ils font les tâches ménagères, gardent les enfants, se marient. La question de leurs droits est mise en débat.
Pourquoi le voir : La série de Lars Lundström (de 2012 à 2014) interroge sur la reconnaissance et le statut de la machine quand ses compétences égalent celles de l’homme. Or, pour la première fois en 2017, le Parlement européen a émis des recommandations sur le droit civil de la robotique, et le robot Sophia, de Hanson Robotics, est devenue citoyenne d’Arabie Saoudite.
Alternative : La série Westworld 16 (Jonathan Nolan, depuis 2016) explore la même question en mettant en scène un parc de loisirs où les visiteurs humains paient pour maltraiter des robots, jusqu’à leur rebellion.
8 / Her 17 : l’IA comme partenaire idéal
Le pitch : Dans un futur aseptisé, un homme solitaire noue une relation sentimentale avec le système d’exploitation qui contrôle ses objets connectés, son smartphone et son ordinateur.
Pourquoi le voir : C’est en découvrant la technologie des chatbots (ou robots conversationnels) que le réalisateur Spike Jonze a eu l’idée de ce film, sorti en 2014, qui explore les bouleversements phycho-affectifs engendrés par les robots. Selon un sondage Havas publié le 10 décembre dernier, 27% des jeunes de 18 à 24 ans se disent prêts à nouer une relation romantique avec un robot dans l’avenir. Mais que se passe-t-il quand on tombe amoureux d’une machine ?
Alternative : « Be right back », l’épisode 1 de la saison 2 de la série Black Mirror 18 (2013), explore la relation qu’une femme en deuil noue avec le clone virtuel de son mari. Dans la réalité, une telle duplication de l’être aimé est actuellement expérimentée aux Etats-Unis.
9 / Person of interest 19 : quand une IA dématérialisée exerce un contrôle politique
Le pitch : Une intelligence artificielle prédit des crimes et avertit un groupe de justiciers anonymes qui s’efforcent de les empêcher. L’algorithme ne précise pas si la personne qu’elle mentionne est la victime ou l’agresseur.
Pourquoi le voir : Cette série met en scène l’ubiquité d’une intelligence artificielle connectée à Internet. Capable de reconnaître un visage dans la foule, le système de surveillance des rues mis en place en Chine en septembre dernier n’est pas sans rappeler l’intrigue de cette série.
10 / Sunspring 20 : un film écrit par une intelligence artificielle
Le pitch : Dans un monde futuriste, trois personnages se débattent avec des histoires d’amour et de meurtre.
Pourquoi le voir : Pour se faire un avis sur le potentiel artistique actuel d’une intelligence artificielle. Le réalisateur Oscar Sharp a travaillé avec le chercheur Ross Goodwing pour tourner ce court-métrage (2016) écrit par une IA ayant choisi de se faire appeler « Benjamin ».
Alternative : La saison 8 de Game of Thrones 21. Il se murmure que les scénaristes ont fait appel à des algorithmes apprenants pour écrire l’ultime saison de cette série, qui devrait être diffusée en 2019.
1 https://www.senscritique.com/film/Metropolis/497318
2 https://www.senscritique.com/film/2001_L_Odyssee_de_l_espace/475251
3 https://www.senscritique.com/film/Interstellar/388583
4 https://www.senscritique.com/groupe/Star_Wars_univers/197
5 https://www.senscritique.com/groupe/Matrix/692
6 https://www.senscritique.com/film/Terminator_2_Le_Jugement_dernier/492468
7 https://www.senscritique.com/film/Ex_Machina/10713376
8 https://www.senscritique.com/film/Blade_Runner/494050
9 https://www.senscritique.com/film/Blade_Runner_2049/7938578
10 https://www.senscritique.com/serie/Marvel_Les_Agents_du_S_H_I_E_L_D/7938819
11 https://www.senscritique.com/film/L_Homme_bicentenaire/381150
12 https://www.senscritique.com/film/A_I_Intelligence_Artificielle/451969
13 https://www.senscritique.com/film/Wall_E/362753
14 https://www.senscritique.com/film/Chappie/8822817
15 https://www.senscritique.com/serie/Real_Humans/405056
16 https://www.senscritique.com/serie/Westworld/16047783
17 https://www.senscritique.com/film/Her/1301677
18 https://www.senscritique.com/serie/Black_Mirror/438579
19 https://www.senscritique.com/serie/Person_of_Interest/448507
20 https://www.senscritique.com/film/Sunspring/21549634
21 https://www.senscritique.com/serie/Game_of_Thrones/225391
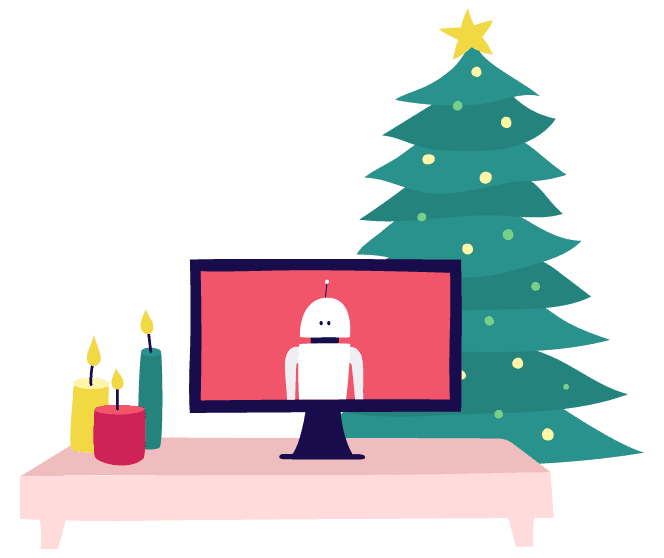
Geeks ou non, le numérique rapproche les petits-enfants et les grands-parents
Des solutions numériques simples d’utilisation permettent de renforcer les liens intergénérationnels au sein de la famille.
Garder un lien étroit avec ses proches n’est pas toujours aisé quand on vit à des centaines, voire des milliers de kilomètres les uns des autres. Pour étudier ou trouver du travail, il est désormais fréquent que les jeunes adultes quittent leur ville – voire pays – de naissance, s’éloignant ainsi de leurs parents et grands-parents.
Entre deux conversations téléphoniques, il est souvent plus pratique de communiquer par mail ou par sms. Echanger avec les membres de leur famille - et notamment leurs petits-enfants - est la première raison qui motive les seniors de tous âges à souscrire à une connexion internet.
Selon le Baromètre du Numérique publié par l’Arcep en décembre dernier, le taux d’équipement en smartphone des personnes âgées de 70 ans et plus continue de progresser : 35% d’entre elles en possédaient un en 2018.
Pour autant, les aînés ne sont pas toujours à l’aise avec l’outil : les touches du clavier sont étroites et engourdissent les doigts arthrosés ; tandis que les yeux fatigués peinent à décrypter les lettres minuscules sur l’écran.
Les codes du langage sms - la concision des échanges et l’emploi des émoticônes par exemple – peut aussi les décontenancer. Installer des applications mobiles – de messagerie instantanée par exemple - peut effrayer : selon l’Arcep, 85% des personnes âgées de plus de 85 ans ne les utilisent jamais.
Les aînés peuvent ainsi éprouver des difficultés à échanger avec leurs petits-enfants, pour qui le smartphone est devenu un outil de communication aussi indispensable qu’incontournable. Mais grâce à l’essor de la Silver Economie, de nouvelles solutions numériques mieux adaptées aux besoins des seniors apparaissent.
Familink, un cadre photo numérique pour les seniors non connectés
En Normandie - berceau des services numériques conçus pour les seniors - la start-up rouennaise AsWeShare propose un cadre photo numérique qui permet aux seniors de recevoir instantanément les photos envoyées par leurs proches, et d’y répondre en appuyant sur un unique bouton. Par ce simple clic, l’expéditeur de la photo reçoit un « like » (ou un « j’aime ») en réaction à la photo qu’il a envoyée. Le cadre photo peut également afficher un message sous forme de texte.
La start-up a veillé à simplifier l’utilisation de ce cadre photo au maximum : pour les proches, le partage peut s’effectuer via l’application mobile de Familink et son site internet, mais aussi par e-mail et par Facebook Messenger ; quant au senior, il n’a pas à se soucier de choisir un opérateur pour souscrire un abonnement à internet puisque le cadre photo est équipé d’une carte SIM 3G qui le rend parfaitement autonome.
Les photos reçues sont stockées dans le cloud, et peuvent être imprimées sur demande. Et pour éviter de troubler le sommeil souvent léger des aînés, le cadre photo se déconnecte automatiquement pendant la nuit.
Réduire le sentiment d’isolement qui nuit à la santé des seniors
Il y a un an, la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) de Normandie, qui teste chaque année de nombreuses solutions numériques pour améliorer le quotidien des seniors, a proposé à une centaine de personnes âgées de découvrir ce cadre photo numérique d’un nouveau genre.
Après un an d’expérimentation, le directeur Action sanitaire et sociale de la Carsat Normandie a reçu tant d’avis positifs sur le dispositif qu’il envisage désormais d’équiper l’ensemble des bénéficiaires de la Carsat dans la région : « Nous n’avions encore jamais rencontré un enthousiasme aussi fort et unanime lors d’un test auprès de nos bénéficiaires : plus de 90% des retraités constatent que ce cadre photo leur a permis de renforcer leurs liens avec leur famille et estiment qu’il a réduit leur sentiment d’isolement », précise Jean-François Capo-Canellas.
Cet outil numérique pourrait contribuer à maintenir les personnes âgées en bonne santé plus longtemps : plusieurs études de psychologie du vieillissement ont montré que la dépression des personnes âgées augmente les risques de maladies, notamment cardiovasculaires. En 2009, Becca Levy, chercheuse à l’Université de Yale, a chiffré à 7,5 ans la perte d’espérance de vie d’une personne due à la vision négative de son vieillissement.
Un journal mensuel pour les nostalgiques du papier
Pour les seniors allergiques à Internet, Neveo propose une autre solution numérique qui facilite tout autant les liens intergénérationnels, tout en conciliant les besoins des différentes générations : le magazine familial mensuel.
Il est imprimé et livré par courrier au domicile des grands-parents, partout dans le monde. Pour le réaliser, les membres de la famille doivent uniquement télécharger leurs photos sur le site internet ou sur l’application mobile dédiée, et rédiger une légende pour chaque image.
Le journal se met en page automatiquement à partir de ces données, qui sont stockées sur les serveurs de l’entreprise Neveo. La grand-mère ou le grand-père qui le reçoit peut alors feuilleter le magazine à loisir, et découvrir les activités de la famille.
Tout comme Familink, le journal familial Neveo s’intègre facilement dans le quotidien des seniors. Très vite, il n’est plus question pour eux de s’en séparer. Et pour les membres de la famille, il est dès lors difficile de ne pas renouveler la souscription de ces services par abonnement.
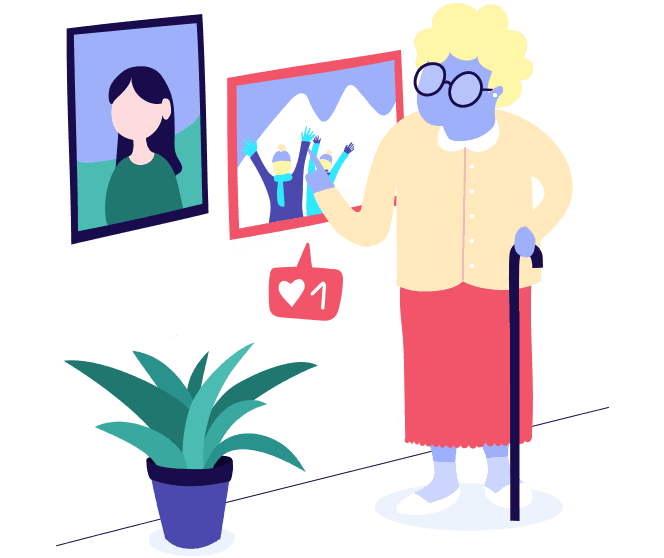
Intelligence artificielle : promesse de vie éternelle... ou de fin du monde ?
Les algorithmes capables d’apprendre par eux-mêmes nous accompagnent déjà dans notre vie quotidienne. Bientôt, ils pourraient nous aider à ne plus vieillir, ni mourir. A moins qu’ils ne sonnent le glas de l’humanité…
Elle n’est pas encore sur toutes les lèvres, mais déjà bien installée derrière nos écrans. L’intelligence artificielle nous accompagne à la maison, dans notre poche ou au bureau pour nous simplifier la vie. Ce sont ces algorithmes auto-apprenants qui répondent en direct aux questions des clients sur les sites de e-commerce ou qui la commande que vous adressez à haute voix à votre smartphone. Leurs compétences en reconnaissance vocale et d’image sont également mobilisées par les médecins pour affiner un diagnostic, ou bien encore par les services de police pour relancer une enquête criminelle au point mort.
Ces algorithmes équipent aussi les robots qui arrivent peu à peu dans nos logements, et ceux qu’utilisent les militaires. Grâce à l’intelligence artificielle, les entreprises françaises pourraient réaliser 20% de gains de productivité d’ici à 2035, ce qui permettrait à la croissance économique française d’atteindre 3% par an, soit le double du rythme actuel de création de valeur1. Certains technophiles inconditionnels de la Silicon Valley annoncent même qu’au cours des prochaines décennies elle nous permettra de dépasser nos limites physiques et intellectuelles, voire… de devenir immortel !
Ces « transhumanistes » s’inspirent des travaux de deux philosophes - le Suédois Nick Bostrom et le Britannique David Pearce, qui ont fondé l’Association Transhumaniste Mondiale en 1998 – et de ceux du futurologue américain Ray Kurzweil – connu pour avoir édicté près de 150 prédictions depuis 1990 avec un taux de réalisation de 86%. Les convictions transhumanistes se sont invitées jusque dans la course à la Maison Blanche en 2016 avec un candidat portant l’étiquette de la cause : Zoltan Istvan avait alors promis rien de moins que la vie éternelle pour tous s’il remportait l’élection présidentielle américaine. Malgré son échec dans les urnes américaines, il reste convaincu que « tout le monde sera converti au transhumanisme d’ici vingt à vingt-cinq ans, de la même façon que l’environnementalisme ne fait plus débat aujourd’hui »2.
La fin de la mort…
Les transhumanistes tablent sur les progrès déjà exponentiels des technologies NBIC (neurosciences, biotechnologies, informatique et sciences cognitives) pour que leur cerveau soit transférable à une machine dès 2050. Des milliardaires investissent sans compter pour que ce rêve se réalise : Larry Page, le fondateur de Google, a créé une entreprise dédiée à ce projet, Calico, qu’il a dotée de 750 millions de dollars ; Peter Thiel, qui a lancé Paypal, place également ses espérances – et une partie de ses 2 milliards de dollars de fortune personnelle – dans les recherches contre le vieillissement et la mort ; Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Facebook), Larry Ellison (Orcale) font également partie des patrons qui visent la vie sans fin.
Figure de proue du transhumanisme, la « serial entrepreneure » transgenre Martine Rothblatt a sollicité le fabricant de robots Hanson Robotics pour donner naissance en 2010 au droïde Bina48, réplique robotique de son épouse. L’humanoïde s’est nourrie de centaines d’heures d’entretiens pour identifier les émotions, les croyances, le vocabulaire et les mimiques de son modèle. Elle est désormais en mesure de tenir une conversation imitant la « vraie » Bina, et singeant 64 expressions faciales différentes.
Eugenia Kuyda, entrepreneure russe, a trouvé un autre moyen de rendre l’être cher immortel, en créant non pas un double, mais un fantôme. Suite au décès accidentel de son ami Roman Mazurenko, la jeune femme basée à San Francisco a alimenté un chatbot (« robot conversationnel ») à l’aide des photos, messages, e-mails et publications sur les réseaux sociaux du disparu. L’intelligence artificielle a ainsi pu découvrir les centres d’intérêts de Roman, son vocabulaire et ses tics de langage. Grâce à ses réseaux neuronaux virtuels, elle est en mesure d’imaginer la réponse qu’il aurait donnée à telle ou telle question, qu’elle formule en adoptant les tournures de phrases qu’il avait l’habitude d’utiliser. Ainsi, Eugenia Kuyda a l’impression que son ami reste présent à ses côtés.
…ou la fin de l’humanité
L’idée d’une existence immortelle a de quoi séduire les romantiques. Mais elle effraie bon nombre de penseurs, à commencer par les philosophes. François Dermange, professeur d’éthique à la Faculté de théologie de l’Université de Genève, voit dans la quête d’immortalité des transhumanistes le reflet d’un hyper-individualisme. S’ils atteignaient leur objectif de vie éternelle, l’idée de « morale » disparaîtrait, tout comme le respect d’autrui, estime le philosophe français Bernard Vergely3. Son homologue Alain Damasio constate lui aussi cette approche égocentrée, associée à un besoin de maîtrise de l’environnement et de sécurité. Selon lui, en cherchant à devenir des dieux, les transhumanistes entrent en réalité dans un processus suicidaire. Leur volonté d’« évoluer » selon leur envie4, en repoussant toutes les limites de la nature humaine, les conduirait à dissoudre l’humanité dans de nouvelles espèces hybrides, et à perdre les codes de pensée et d’actions qui régissent notre monde depuis l’Antiquité.
D’autres voix s’élèvent pour mettre en garde contre l’intelligence artificielle elle-même. Un millier de scientifiques, d’entrepreneurs influents et de chercheurs – parfois spécialisés dans cette discipline - ont ainsi signé en 2015 un appel à réguler le développement de cette technologie. Ils l’imaginent devenir un jour si perfectionnée et indépendante qu’elle n’aurait plus besoin de l’être humain pour prospérer… et pourrait alors décider de l’éradiquer. Parmi les signataires de cette mise en garde contre les « robots tueurs » se trouvaient l’astrophysicien britannique Stephen Hawking, le cofondateur de Microsoft Bill Gates qui redoute la disparition de la plupart des emplois, le cofondateur d’Apple Steve Wozniak qui est certain que les humains deviendront les « animaux de compagnie » des robots, ou encore l’entrepreneur Elon Musk5 qui se dit prêt à dépenser des milliards de dollars dans une « croisade » contre l’intelligence artificielle.
Le temps de la réflexion
L’émancipation des robots - appelée « singularité » - n’est pas à l’ordre du jour, et certains parient qu’elle ne sera jamais possible. Mais la puissance de calcul des nouveaux ordinateurs quantiques et les progrès rapides des algorithmes auto-apprenants invitent tout de même à la réflexion. En 2016, l’intelligence artificielle battait l’homme au jeu de go – réputé le plus complexe du monde, devant les échecs - pour la première fois, après avoir étudié des milliers de parties jouées par les humains. Un an plus tard, elle gagne systématiquement grâce à des stratégies qu’elle a élaborées seule, sans qu’aucun exemple ne lui ait été fourni. Un sondage réalisé par l’Ifop et publié en octobre dernier révélait que deux Français sur trois s’inquiètent de l’essor de l’intelligence artificielle, mais que sept sur dix sont curieux de découvrir son potentiel. La question de l’impact - positif ou négatif – de l’intelligence artificielle devrait donc occuper le débat public pendant de longues années encore. Quant à la réponse, elle devrait dans tous les cas s’imposer à nous au cours des prochaines décennies.
1 Estimation par le cabinet Accenture Institute of High Performance, publiée en décembre 2016. Dans certains pays, ces gains de productivité pourraient s’élever à 40%.
2 Voir : « Zlotan Istvan, candidat transhumaniste », Tracks, Arte, septembre 2015 (https://iatranshumanisme.com/2015/09/22/zoltan-istvan-candidat-transhumaniste-tracks-arte/)
3 Vergely Bernard, La tentation de l’Homme-Dieu, Le Passeur, 2015,138 p.
4 Selon Zlotan Istvan, un être humain qui souhaiterait vivre sous l’eau comme un poisson pourra acquérir des branchies grâce aux nouvelles technologies, d’ici à quelques décennies.
5 L’entrepreneur américain développe des projets futuristes dans l’aérospatiale avec SpaceX, la voiture électrique avec Tesla ou encore le train hyper-rapide avec Hyperloop.
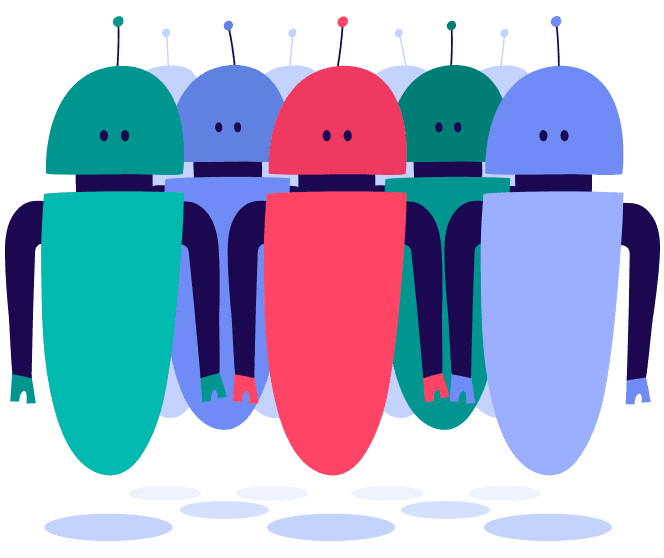
HTTPS : 5 raisons de s'intéresser au cadenas qui sécurise le web
La technologie ‘https’, d’abord utilisée pour les transactions financières, se déploie sur de nombreux sites internet et applications mobiles depuis janvier dernier, avec le soutien des géants du web. De quoi sécuriser la navigation des internautes en évitant le vol de données personnelles.
Il suffit d’un ‘S’ et d’un peu de vigilance pour surfer sur Internet en toute sécurité. Les deux Français sur dix qui ont été victimes de piratage informatique en 2016, selon Symantec, l’ignoraient probablement. Dans son rapport annuel sur la cybercriminalité publié en novembre, cette société de logiciels informatiques détaille les principales attaques subies : le vol de mot de passe (14%), la fraude à la carte de crédit (10%) et le rançonnage contre la ‘libération’ des fichiers de données bloqués par le pirate sur l’ordinateur de l’internaute (4%). Or il existe une solution pour éviter la plupart de ces arnaques : le « https ». Explications :
Le ‘https’ valide l’identité des sites visités
Comme le ‘http’, la technologie ‘https’ indexe sur internet les adresses des sites et de leurs différentes pages et met en relation l’ordinateur de l’internaute avec le serveur qui héberge la page souhaitée. Mais cette petite sœur du http, née au milieu des années 1990, réalise cette connexion en cryptant les données pendant leur transfert entre l’émetteur et le destinataire, grâce aux protocoles SSL (« Secure Sockets Layer ») et plus récemment TLS (« Transport Layer Security »). Pour se représenter l’opération, imaginons que le « https » enferme les données de l’utilisateur dans une boîte noire dont seul le site destinataire a la clé.
Ce cryptage rend impossible les attaques dite « de l’homme du milieu », courantes avec la technologie ‘http’ (sans S) : le pirate se glisse entre l’internaute et le site consulté, et espionne tous les renseignements transmis (mot de passe, nom d’utilisateur, date de naissance, numéro de carte bancaire ou encore contenus publiés). Les données ainsi collectées lui permettent d’effectuer des achats frauduleux. Avec la technologie ‘http’, un pirate peut aussi créer une fausse page web ressemblant à celle d’un site véritable, qu’il insère sur ce site pour détourner l’internaute au moment du paiement.
Ces techniques sont déjouées par la technologie « https » : les informations ne sont lisibles que par le destinataire, dont l’identité est vérifiée, puisque chaque site reçoit un certificat d’authentification, délivré après examen par une autorité de contrôle indépendante. Si ce certificat est absent ou expiré, le système se met en alerte et prévient l’internaute.
Un cadenas vert garantit une navigation sécurisée
Un simple coup d’oeil attentif permet ainsi de surfer sur Internet en toute sécurité. En arrivant sur une page web, l’adresse notifiée dans la barre du navigateur porte des indications sur la fiabilité du site visité. Si elle affiche un cadenas verrouillé et une couleur verte, alors le site est bien identifié et le chiffrement des données transmises est garanti. Tous les navigateurs internet mentionnent cette signalétique en utilisant ces codes de couleur et de forme, notamment Chrome, Firefox, Internet Explorer et Safari, qui sont les plus utilisés dans le monde comme en France selon StatCounter en janvier 2017. Impossible de se tromper… si l’on pense à vérifier !
Pour aider les internautes à surfer sur le web en toute sérénité, les navigateurs adressent des notifications lorsqu’une page que l’on souhaite visiter présente un certificat de sécurité inconnu ou expiré. Pourtant, malgré ces avertissements, trois internautes sur dix choisissent de confirmer leur demande d’accès à la page suspecte, selon l’étude « Alice in Warningland » menée en 2013 par l’Université de Californie et Google. Au risque de tomber dans les filets d’un pirate !
2017, l’année du https
Les géants de l’Internet ont tout intérêt à ce que la Toile soit sûre, et ils s’efforcent donc de sécuriser le web. Google en a fait son combat depuis 2011. Il a déployé le ‘https’ d’abord pour permettre aux internautes identifiés sur son navigateur Chrome d’effectuer des recherches sans détection de leurs mots-clés, puis pour les utilisateurs de la messagerie Gmail et de la plateforme vidéo Youtube. Il a incité les autres sites à suivre son exemple dès 2014, en proposant à tous les sites qui choisissent d’utiliser la technologie ‘https’ un meilleur référencement dans son moteur de recherche Chrome, qui accueille plus de la moitié des recherches mondiales. En observant l’usage de ses propres outils, Google estime que 30% du trafic mondial est aujourd’hui sécurisé. Pour accélérer cette conversion, il a mis en place en janvier dernier des messages d’alerte pour avertir les internautes que toute page non ‘https’ est « non sécurisée ».
De même, Apple refusent les applications mobiles non chiffrées depuis janvier dernier.
Les sites les plus fréquentés ne sont pas toujours les mieux sécurisés
Plébiscité d’abord par les banques et les sites de e-commerce, le « https » reste peu prisé des sites de contenus. Pourtant le risque de vol de données personnelles existe aussi sur ces plateformes. Google observe même que le ‘https’ n’est pas utilisé par défaut par 79 des 100 sites les plus fréquentés du monde (hors Google lui-même), qui représentent au total un quart du trafic mondial. Parmi eux : le site d’enchères en ligne eBay, le géant de l’e-commerce chinois Alibaba et de nombreux médias de toutes nationalités.
Adopter la technologie ‘https’ a un coût limité aujourd’hui. Mais certains redoutent que cette mutation engendre un ralentissement du site préjudiciable, notamment pour la bonne diffusion de la publicité, et une chute de leur trafic. Rien d’insurmontable pourtant : Zack Tollman, membre de la direction technique du magazine américain Wired, a assuré lors d’une conférence en Californie en janvier dernier que le trafic perdu lors de cette mutation avait été regagné en 4 semaines.
Les réseaux sociaux -Instagram, Linkedin, Pinterest ou encore Whatsapp- sont les bons élèves du ‘https’. Facebook l’a même adopté dès 2013.
La vigilance prévaut !
La généralisation du ‘https’ et les alertes des navigateurs ne doivent pas faire oublier les règles de base de la sécurité en ligne : mettez à jour vos logiciels, et vérifiez l’orthographe de l’adresse du site visité. Méfiez-vous, par exemple, d’un site de paiement ‘https’ qui s’appellerait ‘Maiff’ (avec deux F). Certains sites frauduleux adoptent en effet la navigation sécurisée et tentent de se faire passer pour des sites connus en adoptant un nom quasi-semblable.
Ces mesures de bon sens permettent d’éviter la plupart des dizaines de millions de logiciels malveillants nouveaux ou remodelés qui apparaissent chaque mois sur la toile*.
*sources : Symantec, Dell.
– Perrine Créquy
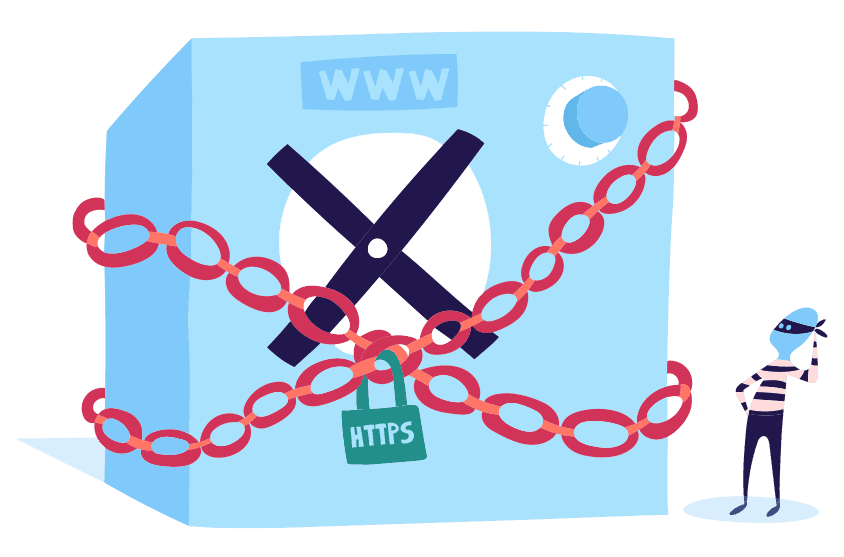
Le tour du monde d'un post Facebook
Pour proposer une sélection de publication personnalisée à chacun de son 1,7 milliard d’inscrits dans le monde, le réseau social doit stocker des milliards de données. Et pour cela, il les fait voyager. Suivons leur périple.
Mesdames les données, attachez vos ceintures, le décollage est imminent ! A chaque fois qu’un utilisateur de Facebook clique sur « publier », il envoie son contenu faire un long voyage. Chaque « J’aime », photo, commentaire, information de profil ou relation d’amitié nouvelle qui fait l’objet d’un post sur le réseau social dispose ainsi d’un passeport pour un tour du monde. Toutes les données de chacun des 1,7 milliard d’utilisateurs de ce site, qui est le troisième le plus consulté du monde, ont la même destination : les États-Unis. Mais selon leur pays de départ, le trajet et les escales diffèrent. Les données des utilisateurs américains de Facebook ne voyagent que sur les lignes domestiques, sans jamais quitter les États-Unis.
Cap sur le cercle polaire
Les données émises partout ailleurs sont des voyageurs internationaux. Suivons par exemple le parcours d’une photo postée sur le réseau social via un smartphone situé à Paris. La suite de 0 et 1 qui décrit l’image en langage informatique est instantanément transférée par les airs, via les antennes-relais wifi, pour rejoindre les câbles de fibre optique qui constituent les autoroutes du réseau numérique. Ces voies portent « Internet » et les données publiées jusqu’aux serveurs de Lulea, en Suède.
C’est en effet aux confins du cercle polaire que Facebook a bâti le « data center » -ou « ferme de serveurs »- qui accueille les données de ses utilisateurs européens, soit plus de 310 millions de personnes. Notre photo en provenance de Paris y séjournera quelque temps. Au fil des jours, elle perdra son caractère de nouvelle venue sur le réseau social, et suscitera de moins en moins de réactions, jusqu’à s’enfoncer dans les profondeurs du flux de publications de son auteur. Évincée des discussions en cours, voire oubliée par les utilisateurs, elle sera toutefois conservée par Facebook comme un contenu « froid ». C’est aux États-Unis que la photo ira aller couler une retraite paisible, dans d’autres serveurs de Facebook, destinés à l’archivage.
Un « tunnel numérique sous l’Atlantique »
Pour ce faire, après avoir quitté les horizons enneigés de Lulea, la photo rejoint le Royaume-Uni, pour se présenter à l’entrée de l’un des câbles de fibre optique qui tapissent le fond de l’Océan Atlantique et qui constituent un véritable « tunnel numérique sous l’Atlantique ». Actuellement, ces voies rapides qui font transiter 90% des milliards de milliards de données issues de tous les sites implantés sur une rive ou l’autre. Mais pour éviter les embouteillages et accélérer le trafic, Facebook et Microsoft ont décidé de construire leur propre câble, qui devrait être opérationnel d’ici à la fin 2017. L’embarquement pour les États-Unis ne se fera donc plus sur les côtes britanniques, mais à Bilbao, en Espagne.
Si notre photo parisienne emprunte ce nouvel itinéraire, elle arrivera sur le territoire américain par la Virginie du Nord, après avoir parcouru 6 600 km. De là, elle rejoindra l’une des trois fermes de serveurs américaines de Facebook : à Forest City en Caroline du Nord, à Altoona dans l’Iowa ou à Prineville dans l’Oregon. L’itinéraire des données pourra être modifié à l’avenir, puisque le réseau social a annoncé la construction prochaine de deux nouveaux « data centers » aux États-Unis (à Fort Worth au Texas, et à Los Lunas au Nouveau-Mexique) ainsi qu’un autre en Europe, précisément à Clonee en Irlande.
Voyager à la vitesse de la lumière
Plus de 1000 serveurs sont mobilisés quand un utilisateur consulte son compte Facebook sur son mobile pendant 30 secondes. Étant hébergées en différents endroits à travers le monde, les données voyagent donc à la vitesse de la lumière. Ou presque : cette rapidité sera atteinte avec le Li-Fi, une technologie française de diffusion des données grâce à des ampoules LED, qui est dix fois plus rapide que le Wifi et qui devrait équiper les smartphones à l’horizon 2020.
Facebook veille à n’oublier aucune donnée. Le géant américain a même inventé une nouvelle technologie de serveurs, plus faciles à réparer, pour garantir sa mémoire immédiate et de long terme, et prévenir le risque de perte d’informations. En se souvenant ainsi de ce qui a suscité l’intérêt de chaque utilisateur, son algorithme peut sélectionner les nouvelles publications qui ont le plus de chances de lui plaire. Mais la collecte et la conservation de ces données ont aussi une valeur marchande pour Facebook. C’est en vendant ces données que le réseau social parvient à vivre et à développer ses services. En 2014, le réseau social gagnait 28,68 dollars (= 27,30 euros) par utilisateur aux États-Unis, soit le double de ses recettes par utilisateur européen (11,60 dollars = 11 euros) et même six fois plus que les revenus tirés des données d’un utilisateur asiatique (4,46 dollars = 4 euros) ou du reste du monde (3,35 dollars = 3,18 euros). Ces écarts de revenus s’expliquent à la fois par l’intérêt des annonceurs pour telle ou telle zone géographique de chalandise, mais aussi par la liberté d’utilisation des données accordée à Facebook par le régulateur de chaque pays.
Passeport, s’il vous plaît
Le gouvernement chinois s’autorise à connaître toutes les données émises par ces citoyens, mais peu enclin à ce qu’une entreprise américaine diffuse des informations sur lesquelles il n’a pas apposé son droit de regard. Le régulateur américain, lui, est de loin le plus souple. L’Europe en revanche exige que l’utilisateur soit prévenu avant qu’un tiers utilise (ou vende) les données des internautes sur son sol.
La transhumance des données pose ainsi la question de la garantie de la confidentialité en fonction de la zone géographique de leur stockage. L’Europe est très active dans ses négociations avec les pays étrangers pour faire respecter la liberté des utilisateurs européens à garder le contrôle sur l’utilisation faite de leurs données. Mais chaque utilisateur a la responsabilité de prendre connaissance des conditions générales de ventes qu’il accepte quand il devient membre d’un réseau social, et de vérifier les réglages de confidentialité. Il reste ainsi maître du « passeport » qu’il donne à chacune de ses publications.
En partenariat avec :
Cafébabel, c’est le premier magazine participatif européen traduit en six langues (anglais, français, allemand, italien, espagnol et polonais). Écrit pour et par les jeunes en Europe, on y parle lifestyle, culture, société et d’histoires que tu ne liras pas ailleurs. Tu veux contribuer à raconter l’Europe « In Real Life » ? Tu peux.
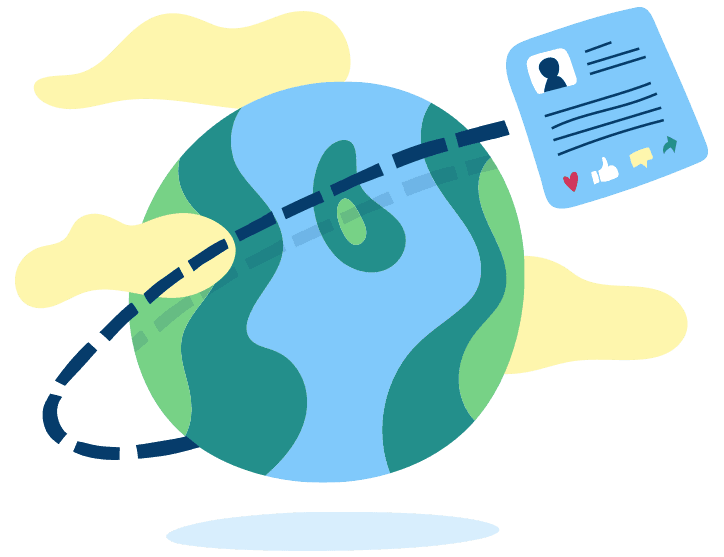
« Hoaxbusters » : ces enfants qui traquent les « fake news »
L’Education nationale forme les élèves à identifier les fausses informations sur Internet. L’institutrice Rose-Marie Farinella propose une méthode dès l’école primaire.
Près de 4 millions d’élèves ont participé cette année à la semaine de la presse et des médias dans l’école. Lors de la trentième édition de cet événement annuel, le centre pour l’éducation aux médias et à l’information (CLEMI) a recensé 18 240 établissements scolaires en France et français à l’étranger participant, soit près de trois fois plus qu’en 1990.
Plus de 1 800 médias se sont également mobilisés en distribuant un million d’exemplaires de journaux, et en organisant des temps d’échanges entre les élèves et les journalistes, et des ateliers pratiques. Par exemple, en Guyane, des collégiens ont ainsi pu mener une investigation grandeur nature, intitulée Classe Investigation en référence au magazine d’enquête télévisé d’Elise Lucet. De même, dans l’Académie de Bordeaux, les lycéens de La Réole se sont interrogés sur la datavisualisation, et les enjeux que pose cette présentation simplifiée de quelques chiffres pour résumer un phénomène complexe.
Les élèves peuvent être exposés aux « fake news » avant l’entrée au collège
Mais face à l’essor des « fake news », la valeur de l’esprit critique n’attend pas le nombre des années : désormais, des élèves sont formés à vérifier les informations diffusées sur Internet dès le primaire
En effet, les réseaux sociaux et les blogs peuvent être de précieuses mines de connaissances autant que des relais de propagande et des vecteurs de radicalité. Or, selon une étude de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (Hadopi) publiée en avril 20191, les trois-quarts des adolescents de 14 ans utilisent régulièrement un ordinateur, tout comme la moitié des enfants de 8 à 10 ans.
Ainsi, avant d’entrer au collège, 83% des jeunes internautes d’une dizaine d’années se connectent pour regarder des vidéos, 59% pour faire des recherches sur Internet, 19% pour envoyer des messages et 11% pour échanger des courriels. Même s’ils sont rares dans cette classe d’âge (3 à 5%), quelques-uns ont également l’habitude de commenter des blogs, participer à des forums, ou publier des images en ligne.
La méthode Farinella est récompensée et plébiscitée
Pour la professeure des écoles Rose-Marie Farinella, « développer l’esprit critique avant l’adolescence est le bon moment, car les élèves manifestent de la fraîcheur et une grande ouverture d’esprit ».
Ancienne journaliste devenue institutrice en maternelle dans l’Académie de Grenoble, elle a eu l’idée de bâtir un programme de sensibilisation adapté aux élèves du primaire dès 2014, quand elle a constaté la recrudescence de fausses informations qu’elle recevait par mail ou sur les réseaux sociaux, et l’inquiétude des parents d’élèves désirant protéger leurs enfants de ces « hoax ». À cette époque, l’Education nationale ne proposait pas d’outils pour accompagner les plus jeunes dans la traque aux fausses nouvelles sur internet.
Depuis 2015, Rose-Marie Farinella déploie son programme d’initiation en classe de CM2, sur la base du volontariat. Sa méthode a été récompensée par trois prix nationaux et deux prix internationaux, dont le Prix mondial de l’éducation aux médias qui lui a été remis par l’Unesco en 20172, et elle a été nommée Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques en août 2017.
Comprendre d’abord ce qu’est une information
Sa formation à l’esprit critique face à l’information en ligne se déroule en 16 séances de trois quarts d’heure, auxquelles se sont ajoutés au fil des années des débats sur la cybercitoyenneté, la liberté d’expression ou encore le racisme.
La première étape consiste à comprendre ce qu’est une information. Pour cela, les élèves concentrent d’abord leur attention sur la différence entre un slogan publicitaire relevant d’une vague promesse, et une information fiable vérifiable.
Ils consultent différents médias et interrogent des journalistes. Ils se familiarisent avec les 5 questions-clés qui permettent au journaliste de synthétiser les faits : « qui ? » « quoi ? », « où ? », « quand ? » et « pourquoi ? ».
Puis les élèves apprennent à croiser les informations en s’appuyant sur des médias fiables : ils s’entraînent à décortiquer l’information, en se renseignant sur l’auteur de l’article, sur la date de publication, sur la date à laquelle l’événement s’est déroulé, et sur le média qui publie l’article et ses règles déontologiques.
Pour prendre en main ces concepts parfois abstraits, ils s’exercent en pratique, grâce à des exercices d’improvisation. Rose-Marie Farinella leur propose ainsi de « couvrir » des faits divers, comme un accident de la route par exemple, ou des sujets clivants, tels qu’une manifestation contre la chasse : certains élèves jouent le rôle des chasseurs, d’autres celui des écologistes, et les apprentis journalistes tentent de rapporter leurs différents points de vue sans prendre parti.
Les élèves constatent alors que tous les témoignages ne se valent pas : certains évoquent des faits, tandis que d’autres relèvent d’une opinion. Ils découvrent également la difficulté de se montrer objectif quand on a soi-même des convictions. Certains scénarios abordent des sujets de société plus sensibles, liés aux questions de radicalité religieuse ou de racisme.
Apprendre à lire les images
L’initiation des jeunes « hoaxbusters »3 passe également par l’analyse critique d’images : « les élèves baignent dans un océan d’images, or les fake news passent beaucoup par l’image », souligne Rose-Marie Farinella. Elle les encourage donc à recontextualiser l’image et à se poser la question du cadrage en se demandant ce qui peut se trouver « hors champ ».
Les élèves sont ensuite envoyés en reportage photo dans les rues voisines de l’école, avec pour mission de montrer ce qui est le plus beau, ou bien le moins esthétique. Ils manipulent également le logiciel Photoshop, pour se rendre compte de la facilité avec laquelle on peut truquer une image. Puis vient le temps de la réflexion sur les intentions des personnes qui produisent de fausses informations : veulent-elles nous faire rire, générer des clics, nous convaincre, ou cherchent-elles à nuire ?
Dessine-moi une chasse aux hoax !
Les élèves participent avec enthousiasme : Rose-Marie Farinella se dit « bluffée par la pertinence de leurs remarques et leur dextérité à utiliser les moteurs de recherche ». Sur les sites web, ils explorent les onglets « à propos », « qui sommes-nous » et « Mentions légales », et sur les réseaux sociaux, ils repèrent les boutons « signaler » pour lutter contre les contenus indésirables.
Ils deviennent acteurs, portent des masques comme de véritables « détectives du web », et ils produisent à leur tour des contenus : leurs missions d’investigations sont en effet filmées et diffusées sur la chaîne Youtube « Hygiène mentale »4, animée par Christophe Michel de l’Observatoire zététique5.
Très content de transmettre ce qu’ils ont appris à leur famille, ils terminent le programme en réalisant un dessin libre, inspiré de ce qu’ils ont découvert pendant leur initiation. Leur investissement est gratifié d’un diplôme qu’ils reçoivent en prononçant solennellement le « serment de la souris » : « Je jure sur la souris de mon ordinateur qu’avant d’utiliser ou de retransmettre une information, toujours je la vérifierai ! ».
Continuez de réfléchir au sujet en participant à l’enquête lancée par la MAIF et VILLES INTERNET sur la désinformation. Pour prendre part à cette démarche originale, et pour auto-évaluer votre relation à l’information, c’est ici.
1 « Pratiques culturelles dématérialisées des 8-14 ans », Hadopi, Avril 2019 : Lien vers le pdf
2 Le troisième prix mondial d’éducation aux médias de l’Uneo a été remis le 20 octobre 2017 à Kingston, en Jamaïque.
3 Littéralement : « chasseurs de canulars » (en référence aux chasseurs de fantômes du film « Ghostbusters »)
4 Voir les épisodes « EMI » 1, 2, 3 et 4 sur la chaîne « Hygiène mentale » : https://www.youtube.com/channel/UCMFcMhePnH4onVHt2-ItPZw
5 L’Observatoire zététique est une association grenobloise qui a pour but la promotion et la diffusion des méthodes et techniques basé sur le scepticisme scientifique.

Cyberharcèlement : un fléau qui débute à l'école
Les réseaux sociaux et les outils numériques décuplent l’impact des actes de harcèlement, poussant parfois les victimes au suicide. Des solutions existent pour endiguer la progression du cyberharcèlement.
Pour cette rentrée 2019-2020, les élèves sont dotés des traditionnels trousses, cartables et cahiers… mais aussi d’un droit nouveau : celui de suivre une scolarité sans harcèlement. C’est l’une des mesures phares de la loi « Pour une école de la confiance », entrée en vigueur le 28 juillet dernier. Un élève sur quatre (22 % des 18-24 sondés en février dernier par l’IFOP1) en serait victime. Ce nombre pourrait être bien plus élevé dans les faits, car la moitié des harcelés n’oseraient pas parler. Selon une étude2 menée aux Etats-Unis en avril 2019 par les chercheurs Sameer Hinduja et Justin Patchin auprès de jeunes de 12 à 17 ans, la part des collégiens victimes de cyberharcèlement a doublé en 2019 par rapport à 2007.
Ainsi, ce sont aujourd’hui quatre collégiens américains sur dix - et autant en France selon la professeure de Sciences de l’éducation Catherine Blaya3 - qui confient avoir été la cible au moins une fois dans leur vie de cyberharcèlement, c’est-à-dire d’« un acte agressif et intentionnel perpétré par un individu ou un groupe d’individus au moyens de formes électroniques de communication, de façon répétée, à l’encontre d’une victime qui ne peut pas facilement se défendre seule »4. Le plus souvent, ce « cyberbullying » s’exprime sous la forme de commentaires blessants ou de rumeurs diffusés en ligne. Dans 10 % des cas, il inclut la diffusion – par SMS ou sur internet - d’insultes, de photos dégradantes ou à caractère sexuel de la victime, voire de menaces de violence physique.
Les chercheurs constatent que les jeunes Américaines sont davantage exposées au cyberharcèlement que les garçons. En France, elles sont aussi plus nombreuses à être l’objet de rumeurs sur les réseaux sociaux (13 % vs. 6 %), d’insultes sur leur apparence physique (20 % vs. 13 %) et de diffusion de photos intimes sans leur accord (4 % vs. 1,5 %)5.
Cyberbullying : des harceleurs qui ne se cachent pas, et des témoins muets
Lors de l’enquête de Sameer Hinduja et Justin Patchin, 15 % des jeunes interrogés ont reconnu avoir commis au moins un acte de cyberharcèlement envers un de leurs camarades. Pour certains, le cyberharcèlement vise à s’imposer comme un « leader » auprès de leurs camarades ; pour d’autres, il s’agit de suivre les pratiques d’un groupe pour ne pas s’en faire exclure. En effet, les actes de cyberharcèlement sont rarement tenus secrets par leurs auteurs. Une majorité de jeunes sont témoins des actes de cyberharcèlement, mais 60 % d’entre eux gardent le silence. Or, les conséquences pour les victimes sont graves : décrochage scolaire, dépression, voire suicide.
Le harcèlement scolaire est renforcé dans la sphère numérique
S’il a toujours existé, le harcèlement scolaire prend une tout autre ampleur à l’ère des réseaux sociaux : « il suffit d’un simple clic pour humilier quelqu’un de façon rapide, groupée (avec bien plus de spectateurs que dans les couloirs de l’école) et indirecte (sans s’adresser physiquement à la victime) », souligne l’association Marion Une Main Tendue7. Via les réseaux sociaux, auxquels les jeunes sont souvent constamment connectés grâce aux smartphones, le harcelé ne connaît plus de répit ni de jour, ni de nuit.
Pour lutter contre ce fléau, la sensibilisation des jeunes est essentielle. Des outils sont mis à disposition des enseignants pour identifier le harcèlement et en parler en classe : outre le Guide de prévention des cyberviolences en milieu scolaire, le gouvernement a mis en place une plateforme « Non au harcèlement » pour conseiller les victimes et les témoins, et les orienter vers les numéros gratuits de l’association E-Enfance, qui peut écouter mais aussi aider à obtenir le retrait des publications dégradantes. Dès la maternelle, des actions de prévention peuvent être menées par le jeu, afin de développer l’empathie des enfants dès le plus jeune âge. Au collège et au lycée, différentes interventions peuvent être organisées par des associations.
Responsabiliser les plateformes en ligne et les élèves contre le cyberharcèlement
Ce défi louable est loin d’être gagné : le vilipendage est en effet monnaie courante sur les réseaux sociaux. Une critique violente peut fuser dans une réaction « à chaud », sans prise de recul, sur des plateformes qui encouragent l’expression de l’émotion « sur le vif ». Les icônes des jeunes n’échappent pas à ce phénomène : la Youtubeuse Enjoy Phoenix a subi une violente campagne de dénigrement au sujet de son apparence physique, le chanteur Bilal Hassani, emblème de la communauté LGBT+, a reçu de nombreux commentaires racistes et homophobes.
Ces comportements ne s’arrêtent pas toujours avec la fin de la scolarité : l’affaire de la « Ligue du LOL » a révélé que le cyberharcèlement (en l’occurrence à caractère sexiste) peut sévir aussi au sein des entreprises. Selon l’IFOP, 8 % des Français de plus de 18 ans ont été victimes de cyberharcèlement. Sur le plan juridique, la loi Avia contre les contenus haineux, qui vise à responsabiliser les plateformes en ligne en les contraignant à retirer un contenu signalé (car raciste, homophobe, discrimination religieuse, etc.) sous 24h, vise à mieux protéger les victimes - la loi contre le harcèlement en ligne de 2014 n’ayant permis que 17 condamnations. Mais l’éducation aux bonnes pratiques numériques et le développement de l’empathie dès le plus jeune âge restent les moyens les plus efficaces de lutter contre le cyberharcèlement, et d’endiguer enfin sa progression.
1 « Les Français et l’expérience du harcèlement en ligne » : https://www.ifop.com/publication/…
2 « Données 2019 du cyberharcèlement » (en anglais) : https://cyberbullying.org/2019-cyberbullying-data
3 4 5 Citée dans le « Guide de prévention des cyberviolences en milieu scolaire » édité par le Ministère de l’Education en novembre 2016 : http://cache.media.education.gouv.fr/file/11_-_novembre/…
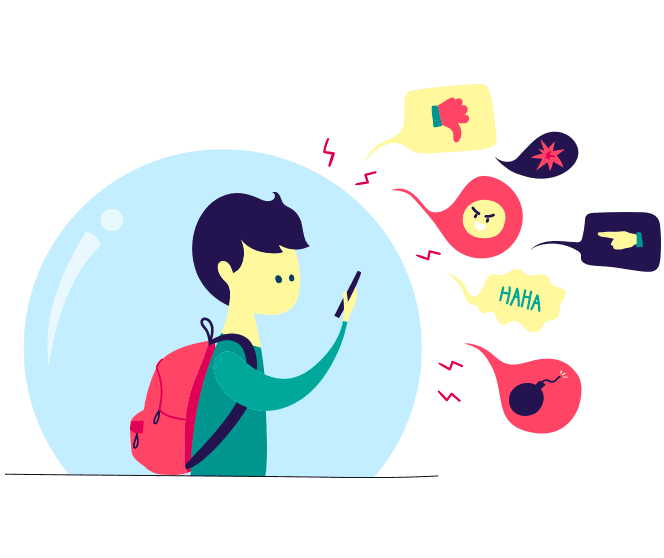
Réduire son empreinte carbone grâce au numérique
Des sites internet, des applications et des objets connectés peuvent nous aider à agir à notre échelle pour réduire l’impact de nos activités et consommations sur l’environnement.
Et si le virtuel pouvait nous aider à sauver la planète ? Grâce au numérique, les émissions mondiales de CO2 pourraient être réduites de 20% d’ici à 2030, selon Global e-sustainability initiative (GeSI). La France compte donc sur ces nouvelles technologies pour atteindre l’objectif de neutralité carbone 1 qu’elle s’est fixé à l’horizon 2050.
Brune Poirson, la secrétaire d’Etat à l’Ecologie, et Mounir Mahjoubi, son homologue au Numérique, ont donc accueilli avec attention les 26 propositions d’action détaillées dans le livre blanc « Numérique et Environnement : faire de la transition numérique un accélérateur de la transition écologique » 2, présenté le 19 mars dernier.
Si ces propositions sont destinées aux pouvoirs publics, les citoyens désirant agir pour l’environnement ne sont pas oubliés : chacun pourra bientôt s’inspirer des conseils du guide « écolo-geek » commandé par le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, qui devrait paraître avant l’été. En attendant de découvrir ces recommandations, voici 5 pistes à suivre pour réduire votre empreinte carbone grâce au numérique.
1. Bien choisir ses équipements
Fabriquer des ordinateurs, tablettes et smartphones neufs engloutit des ressources naturelles rares. Produire et utiliser une seule puce électronique de 2 grammes nécessite ainsi 1,6 kilogramme de carburant fossile, 72 grammes de produits chimiques, 32 litres d’eau et 700 grammes d’azote 3. Il faut 60 métaux différents pour construire un téléphone portable, dont une vingtaine seulement est recyclable actuellement. La facture environnementale associée à l’achat d’un nouvel appareil numérique est donc lourde.
En outre, la durée d’utilisation d’un ordinateur a été divisée par 3 en 30 ans (entre 1985 et 2015) passant de 11 à 4 ans 4. Le premier réflexe à adopter pour réduire son empreinte environnementale serait donc de ne pas céder aux sirènes de la surconsommation, et de s’interdire de se séparer d’un appareil au seul motif qu’il en existe un plus récent.
Quand le moment est venu de renouveler son équipement, il est préférable d’opter pour un produit respectant certains critères de durabilité et fabriqué par une entreprise respectueuse de l’environnement, répertoriée par Greenpeace 5. Pour ce qui est de son ancien appareil, il est possible d’en faire don via un groupe Facebook ou une application comme Geev, par exemple. En cas de panne, des sites internet comme SOSav et Ifixit expliquent comment réparer son smartphone soi-même et prolonger ainsi sa durée de vie.
2. Utiliser un moteur de recherche écolo et vider sa poubelle virtuelle
L’Agence française de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (Ademe), a listé quelques principes pour surfer sur Internet sans gaspiller d’énergie. Il faut en effet autant d’électricité pour envoyer un e-mail de 1 Mo à un destinataire unique que pour allumer une ampoule de 60 W pendant 25 minutes. Et faire une recherche sur internet requiert autant d’énergie que faire bouillir de l’eau. Les recherches en ligne d’un internaute français représentant ainsi 9,9 kg équivalent CO2 par an.
Pour compenser cet impact environnemental, des moteurs de recherche écologiques utilisent les revenus publicitaires générés par les recherches des internautes pour financer des projets de développement durable (comme les moteurs de recherche français Lilo et Ecogine). Le moteur de recherche allemand Ecosia a ainsi planté 10 millions d’arbres depuis sa création en 2009.
3. Mesurer sa consommation d’énergie, d’eau et gérer ses déchets
Les objets connectés nous aident également à mesurer et optimiser notre consommation de ressources naturelles, en modulant à distance la température de chauffage de la maison, par exemple.
Le compteur électrique intelligent Linky d’EDF permet ainsi d’identifier la consommation d’énergie de chaque appareil de la maison, et de recevoir des conseils pour l’optimiser. Le pommeau de douche Hydrao, de la start-up grenobloise Smart & Blue, couplé à une application mobile dédiée, mesure et limite le volume d’eau utilisé à chaque douche. D’autres applications comparent la consommation énergétique des appareils électroménagers pour s’équiper « responsable » (par exemple : EcoGator, de l’agence de l’énergie autrichienne). Certaines nous éclairent sur le tri sélectif des déchets : Citeo aide ainsi à identifier les déchets à jeter dans les bacs verts ou jaunes.
4. Des applications pour se déplacer sans (trop) polluer
L’essor du numérique a également permis l’apparition de nouvelles solutions de mobilité moins polluantes que la voiture personnelle, et disponibles en quelques clics. Blablacar a ainsi popularisé le covoiturage en France dès 2006, tandis que Drivy permet de louer ponctuellement une voiture auprès d’un particulier quand celui-ci ne l’utilise pas. De son côté, l’application Rézo Pouce propose à la fois le partage de véhicule et l’auto-stop dans des régions rurales.
D’autres applications encouragent le recours aux moyens de transports « doux », comme la marche, le vélo et les transports en commun. Citymapper et Whim permettent ainsi de comparer les différents modes de transport disponibles et leur coût, ou encore de combiner différents moyens de mobilité dans un même trajet.
5. Eduquer aux gestes verts dès le plus jeune âge
Pour découvrir de nouvelles astuces et actions à mettre en œuvre pour participer à la transition écologique, l’application mobile 90jours propose un défi quotidien à relever pendant trois mois. Acheter en vrac, emballer ses cadeaux dans du tissu, brancher ses appareils électriques sur une multiprise avec interrupteur… les épreuves peuvent être relevées par tous les membres de la famille.
De nombreuses applications ludiques permettent enfin de sensibiliser les plus jeunes aux éco-gestes : BabyBus, Okaïdi Planet Challenge, Wasteblaster, ou encore Cleanopolis en réalité virtuelle. A l’occasion de la Journée de la Terre, Pokemon Go a annoncé le lancement de la « Mission Blue », une version « écolo » du célèbre jeu de chasse en réalité augmentée, mobilisant les joueurs pour une traque aux déchets à travers le monde.
1 Les émissions de gaz à effet de serre sont intégralement compensées par différents moyens comme la plantation d’arbres par exemple.
2 Iddri, FING, WWF France, GreenIT.fr (2018). Livre blanc Numérique et Environnement.
3 Eric Williams, Robert Ayres et Myriam Heller, « The 1.7 Kilogram Microchip: Energy and Material Use in the Production of Semiconductor Devices », Environmental Science & Technlology, 2002.
4 Guide pour un système d’information éco-responsable, Frédéric Bordage, WWF, 2011 – http://www.greenit.fr/sites/greenit.fr/files/WWF-GUIDE-NTIC_1.pdf
5 Voir le tableau des fabricants, pages 8 à 13 de l’étude « Clicking clean: who is winning the race to build a green internet » publiée par Greenpeace en janvier 2017.

Comment se rendre invisible pour les machines
La reconnaissance d’images facilite la vie quotidienne en ligne, tout comme l’identification par données biométriques. Mais elle met en péril vos données personnelles. Chercheurs et artistes explorent des solutions pour déjouer l’acuité des machines.
Les robots ne ‘likent’ jamais, mais ils adorent vos photos. Ils sont désormais capables de vous identifier, mais aussi de reconnaître qui vous accompagne, ce que vous êtes en train de faire, quelles marques vous portez, quels objets vous entourent, voire quelle est votre humeur du moment. Et ils sont nombreux à scanner les 3 milliards d’images partagées chaque jour sur les réseaux sociaux, selon l’analyste américaine Mary Meeker. En effet, plus de la moitié du trafic Internet mondial est l’œuvre de machines - dont des robots traqueurs d’images - et non d’humains, indiquait la société spécialisée en cybersécurité Imperva. DeepFace de Facebook (interdit en Europe) et le projet de recherche FaceNet de Google figurent parmi les plus connus.
Le monde du shopping raffole lui aussi des technologies de reconnaissance d’image : les fashionistas s’épargnent du temps en lèche-vitrine fastidieux grâce à des applications qui trouvent où est vendu un vêtement qu’elles auront pris en photo dans la rue, et les e-commerçants l’utilisent pour mener des études de marché. Les états et les aéroports y voient une opportunité en matière de lutte contre le crime. Les banques ne sont pas en reste, et proposent de passer un ordre de paiement en adressant un selfie. MasterCard va déployer une telle application cette année au niveau mondial, après l’avoir testée aux Pays-Bas, aux États-Unis et au Canada.
L’identification biométrique simplifie la vie quotidienne en ligne. Et surtout, le numérique qui répond au doigt et à l’oeil se veut plus sûr qu’un traditionnel mot de passe, puisque chacun dispose d’un visage et d’empreintes digitales uniques, qu’il ne risque pas d’égarer. Mais les pirates informatiques se tiennent en embuscade, et se frottent les mains à l’idée de récupérer vos paramètres biométriques. Une simple photo postée sur un réseau social peut suffire pour détourner votre identité. Une note du Centre de recherche de l’École des Officiers de la Gendarmerie nationale alertait sur les risques de détournement des informations biométriques dès avril dernier. L’usurpation d’identité pourrait donc revêtir à l’avenir des conséquences plus dramatiques qu’aujourd’hui : on peut remplacer un numéro de compte et de carte bancaire ou refaire ses papiers d’identité, mais on ne peut pas changer d’iris.
Des chercheurs et des artistes étudient donc les parades pour se rendre méconnaissable par les logiciels de reconnaissance faciale. Les voici :
1. Cachez cette main que les robots sauraient voir !
Que celui qui n’a jamais fait le « V » de la victoire avec ses doigts lève la main ! Pourtant ce signe internationalement connu - sous le nom de « peace » - s’avère aujourd’hui des plus dangereux. Professeur à l’Institut National d’Informatique du Japon (NII), Isao Echizu a démontré que les geeks malintentionnés peuvent extraire votre empreinte digitale à partir d’une photo exposant la pulpe de vos doigts à moins de trois mètres de l’objectif, et l’utiliser ensuite pour se faire passer pour vous sur Internet, voire pour pirater votre smartphone. C’est ce qu’ont prouvé dès 2014 les hackers berlinois du collectif Chaos Computer Club, qui avaient récupéré sur photo l’empreinte de la ministre allemande de la Défense, Ursula von des Leyen, qu’ils avaient ensuite reproduite sur un gant en latex qui avait trompé les lecteurs biométriques de l’iPhone.
Pour déjouer les pirates, Isao Echizu et son équipe ont mis au point un procédé pour recouvrir le bout de ses doigts d’un film transparent, afin de masquer ses empreintes digitales ou même de créer de faux sillons qui seront inexploitables par les pirates.
2. Changer de visage chaque jour
L’artiste américain Adam Harvey a exploré comment déjouer les logiciels de reconnaissance faciale grâce au maquillage et à la coiffure avec le projet « CV Dazzle ». Les robots fondent leur analyse sur des points précis du visage : les ailes du nez, les pommettes, les arcades sourcilières, la bouche. Il suffit d’un camaïeu de fonds de teint, de mèches de cheveux plaquées sur le front ou enroulées sur la joue pour modifier les traits et mettre en échec les robots détecteurs. Un tutoriel (en anglais) sur Youtube de Jillian Mayer met en scène cette technique. Infaillible. Mais il faut assumer ce style cubiste qui ne passera pas inaperçu au bureau.
3. L’essentiel est dans l’accessoire
Trois chercheurs du Département de Sciences informatiques de l’Université Cornell, basée à Ithaca aux États-Unis, ont publié en 2016 une étude exhaustive sur les moyens de tromper l’algorithme de reconnaissance faciale de Facebook, capable d’identifier dans 97% des cas et en moins de 5 secondes une même personne sur deux images différentes. Michael Wilbert, Vitaly Shmatikov et Serge Belongie ont étudié l’impact de l’édition d’une image : la rendre plus sombre, plus floue, opérer une rotation pour incliner le visage… Aucune ne permet de masquer le sujet aux yeux des robots, si ce n’est la technique « du léopard » : en parsemant votre photo de taches noires. Une autre option tout aussi efficace consiste à poser avec des accessoires qui perturbent les robots : des lunettes à monture rayée ou encore une casquette équipée de LED. Totalement invisibles par votre voisin de table, ces petites ampoules créent un halo de lumière capable de dissimuler votre visage sur une photo. Porter une écharpe qui masque la bouche et le menton est également un défi que les robots ne savent pas - encore - relever.
4. Prendre une pose à moitié naturelle
Dans cette même étude, les chercheurs de l’Université Cornell remarquent que les sujets qui cachent la moitié de leur visage avec leur main (paume cachée, bien entendue) ne sont pas identifiés par les robots. Cette technique s’avère aussi efficace quand le visage est partiellement dissimulé par un objet. Faites vos selfies en croquant dans un burger.
5. Se fondre entre les lignes
La reconnaissance faciale s’applique aussi aux vidéos. Dans « How not to be seen », une oeuvre de 2013, l’artiste allemande Hito Steyerl énumère différentes façons de se rendre invisible des caméras et de disparaître « en pleine vue ». En posant devant des fonds rayés mêlés d’aplats de couleurs, l’image est saturée d’informations, ce qui la rend floue et difficile à lire par les caméras. C’est pourquoi les vêtements à rayures sont proscrits sur les plateaux de télévision.
6. Ne pas poster ses photos sur les réseaux sociaux
Radicale mais efficace, c’est la seule technique garantie face aux progrès continus de l’intelligence artificielle et de la reconnaissance faciale.
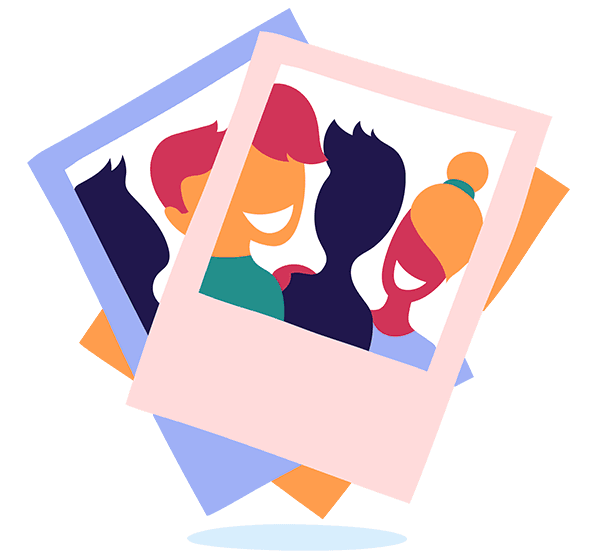
Vos données peuvent rapporter gros
Votre navigation sur internet en dit long sur vous. Ces informations précieuses permettent aux e-commerçants de vous proposer leurs produits au moment où vous en avez besoin, et d’augmenter leurs ventes. Découvrez la valeur de vos données personnelles.
« Si c’est gratuit, vous êtes le produit. » Ce constat est devenu proverbial sur Internet. Le moindre mouvement en ligne de chaque internaute est scruté par des programmes informatiques destinés à recueillir ses données personnelles pour aider les e-commerçants à lui adresser la publicité qui l’intéresse, au bon moment. Ces “trackers” et “cookies” se cachent dans des diaporamas photo, des sondages, des tests et quizz, des jeux-concours ou encore des comparateurs de prix. Ils enregistrent l’adresse IP de votre ordinateur et étudient l’historique de votre navigation pour déterminer vos centres d’intérêt et vos préoccupations du moment. Ainsi, après avoir fait quelques recherches en ligne sur un modèle de voiture, vous découvrirez en visitant votre profil Facebook une publicité pour ce constructeur automobile. Sachant que l’internaute est intéressé par son produit, le vendeur en ligne peut alors lui adresser une remise ou une offre spéciale pour le convaincre d’acheter chez lui plutôt que chez un concurrent. Et ça marche : le chiffre d’affaires issu des activités de ‘big data’ devrait croître de 50% d’ici à 2019, par rapport à 2016, pour atteindre 187 milliards de dollars dans le monde, selon les prévisions du cabinet IDC.
Des chasseurs de données discrets, mais efficaces
Avides de découvrir vos projets personnels, votre état de santé et vos intentions d’achats, les e-commerçants recueillent eux-mêmes vos données de navigation ou les achètent auprès de sociétés spécialisées. Auteurs d’« Anonymat sur Internet : Comprendre pour protéger sa vie privée » (Eyrolles, 2013), Martin Untersinger et Benjamin Bayart chiffrent à une centaine, le nombre de ces entreprises spécialisées dans la chasse aux informations de navigation, qui sont ensuite vendues aux e-commerçants par l’intermédiaire de sociétés négociantes.
Parmi ces courtiers de la donnée, BlueKai, rachetée par l’américain Oracle en 2014, compile 80 sources différentes, et traite 50 millions d’informations d’internautes par jour selon les auteurs. Datalogix, elle, vend les informations d’achats qu’elle extrait des transactions bancaires en ligne et dans les boutiques. Elle détiendrait plus de 1000 milliards d’informations détaillées sur les achats réalisés auprès de 1400 marques, selon une enquête publiée en 2014 par la journaliste Loïs Beckett. Acxiom, une société américaine qui dit « gérer et personnaliser 1 trillion d’interactions en ligne par semaine » propose aux marketeurs des statistiques spécifiques, issues des 700 millions de données de consommateurs qu’elle possède, selon la Federal Trade Commission. L’agence américaine de contrôle des activités commerciales estime qu’Acxiom a généré l’an dernier 850 millions d’euros de chiffre d’affaires grâce à la vente de données.
Peut-être les vôtres. Rien qu’en France, Acxiom assure pouvoir fournir l’adresse postale de 22 millions de foyers, l’adresse mail de 46 millions de comptes de messagerie, et 15 millions de numéros de téléphone… Mediapost, filiale du groupe La Poste, détient deux fois plus d’adresses postales, moitié moins d’adresses en ligne et autant de numéros de téléphone. Interrogé lors d’un reportage de Cash Investigation diffusé en octobre 2015, un responsable a confié -sous couvert d’anonymat- que cette société vend des fichiers clients aux e-commerçants, par exemple un lot de « 200.000 personnes avec enfant qui veulent acheter une voiture dans les trois prochains mois ». Une commande qu’il dit pouvoir livrer… en un quart d’heure !
Chacun de vos clics vaut quelques centimes
Les réseaux sociaux recueillent également les informations contenues dans vos posts, commentaires et “likes” avec assiduité pour les revendre sur le colossal marché de la data. Grâce au ciblage publicitaire permis par les données recueillies, voici ce que rapporte un utilisateur aux géants du web gratuit, selon une enquête dévoilée par Capital.fr avec les agences de publicité en ligne Ad’up et Makemereach en août dernier :
- 0,002 euro : pour chaque affichage d’une publicité géolocalisée sur le trajet d’un utilisateur de Waze
- 0,0056 euro : pour chaque photo sponsorisée affichée sur un profil Instagram
- 0,05 euro pour chaque publicité vidéo visionnée pendant au moins 30 secondes sur Youtube
- 0,15 euro : pour chaque clic d’un internaute CSP+ sur une publicité ciblée sur Twitter
- 0,15 euro : pour chaque clic d’un internaute sur un bandeau publicitaire sur Gmail
- 0,65 euro : pour chaque clic sur une publicité sur Facebook
- 2 euros : pour chaque clic d’un internaute CSP+ sur une publicité ciblée sur Google
- 4 euros : pour chaque clic d’un internaute CSP+ sur une publicité ciblée sur Linkedin
Pour valoriser vos données, suivez un régime !
Aux yeux des courtiers de données et des e-commerçants, nous ne sommes pas tous égaux en matière de données personnelles. Votre profil prendra de la valeur si vous attendez un enfant -en particulier si c’est le premier- ou si vous êtes fiancé -surtout si le mariage est prévu dans le mois. Et si vous souffrez d’une maladie chronique, vous serez la coqueluche des publicitaires !
Le Financial Times a mis en ligne un simulateur pour permettre à chacun de calculer la valeur de ses données personnelles. Chez un courtier en données, les informations de base -votre âge, votre code postal, votre sexe et votre niveau d’éducation- rapportent chacun 0,0005 dollar. Votre origine ethnique vaut dix fois plus. Connaître votre profession vaut entre 7 et 10 cents si vous exercer l’un des 24 métiers chéris des publicitaires, comme : pilote, avocat, comptable, ingénieur, agent immobilier ou d’assurances, entrepreneur, professionnel de la santé, du monde associatif, des ressources humaines, de la banque et de la finance, ou encore de la cosmétique et de l’industrie pharmaceutique.
Votre consultation de sites en lignes est valorisée à quelques dixièmes de cents, trois fois plus si vous vous intéressez à l’automobile plutôt qu’aux recettes de cuisine. Vos intentions d’achats valent autant, sauf s’il s’agit d’un téléphone portable : votre profil sera revalorisé d’un cent.
Vous êtes propriétaire ou vous venez de déménager ? Alors vous valez 8 cents de plus ! Idem si vous êtes propriétaire d’un bateau ou d’un avion. Si vous préférez la salle de fitness aux croisières, ne vous inquiétez pas : les annonceurs aussi ! Ils sont également friands des adeptes du régime, dont les données valent 10 cents de plus, soit autant que celles d’un milliardaire. Obésité, migraines, reflux gastriques, dépression, cholestérol : vos données de santé battent tous les records, à 20 cents pièce.
A profil et intentions d’achats similaires, un internaute américain rapportera deux fois plus qu’un Espagnol. Les chercheurs espagnols Ángel et Rubén Cuevas l’ont montré dans le cadre du projet européen TYPES. Leur plateforme Facebook Data Valuation Tool permet à chacun d’estimer les profits réalisés par le réseau social à partir de ses données personnelles, qu’il clique ou non sur des contenus publicitaires.
Arrondir ses fins de mois en vendant ses données personnelles
Le commerce des données personnelles interpelle les gouvernements et les associations de défense des libertés de chaque côté de l’Atlantique. Chargé de cours en psychologie et en science des données, à l’Université de Stanford, Michal Kosinski a montré en 2013, lors de son doctorat à Cambridge, qu’il est possible de profiler un utilisateur de Facebook – et de déterminer ses orientations sexuelle, politique et religieuse - en étudiant 68 de ses posts. Un autre chercheur américain a démontré que 87% des Américains peuvent être identifiés nominativement si l’on connaît leur âge, leur sexe et leur code postal.
Pour préserver les libertés individuelles, l’Union européenne a prévu de durcir dès 2019 les contraintes législatives pour les entreprises en matière de collecte et d’utilisation des données personnelles des internautes. Créer une taxe sur la collecte de cette nouvelle matière première est également en débat, tant en Europe que dans l’Etat de Washington.
Des start-ups entendent contourner ces questions en rémunérant les internautes qui acceptent de fournir leurs données personnelles. Comme la new-yorkaise Datacoup, la jeune pousse française Kwalead a lancé une plateforme proposant des sondages et des questionnaires dans 100 catégories, comme la banque, les travaux ou encore l’automobile. Les internautes inscrits gagnent entre 1 et 70 euros pour chaque étude à laquelle ils répondent, dans la limite d’un total de 500 euros par mois. Kwalead, qui a lancé ce service en janvier dernier, entend séduire 500.000 membres d’ici à la fin de l’année. Reste à savoir si les Français sont prêts à se mettre à nu en ligne pour monétiser leurs données.
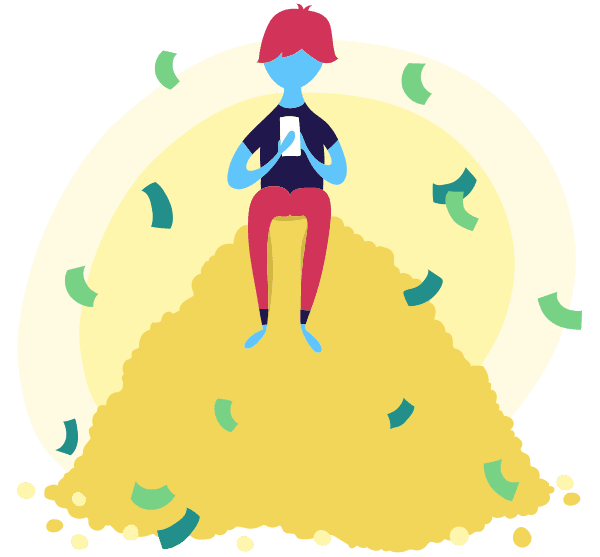
La vie secrète d'un datacenter
Dans ce lieu qui abrite les serveurs informatiques de nombreuses entreprises se nouent bien des enjeux. Rares sont ceux qui ont pu visiter ces temples de la donnée. Poussez donc avec nous la porte du datacenter PA4 d’Equinix à Pantin.
Au milieu d’une zone industrielle palpite un cœur de l’Internet en France. A deux pas de la gare RER de Pantin, un bâtiment colossal et gris s’étend, semblable aux autres entrepôts qui se concentrent dans ces rues fréquentées seulement par des camions de livraison. Derrière la façade sans logo se cache un poids-lourd du numérique, bien connu des professionnels : l’américain Equinix, un géant du stockage de données, qui se targue d’être le seul acteur de son secteur implanté sur les cinq continents.
Pour passer les grilles de l’enceinte et les portes de ce datacenter, il faut montrer patte blanche : présenter sa carte d’identité, signer le registre des visites, et attendre qu’on vienne vous chercher.
On ne déambule pas dans les 16.000 m2 exploitables du lieu sans escorte. Et pour cause : c’est ici que sont hébergés les serveurs de nombreuses entreprises actives sur la Toile. « La plupart de nos clients préfèrent taire le lieu d’installation de leurs serveurs et nous respectons leur désir de confidentialité », souligne notre guide, Fabien Gautier, le directeur marketing et business développement d’Equinix France.
Il ne citera donc que quelques-uns des 800 clients d’Equinix en France : la start-up française star de la publicité en ligne Critéo, le groupe de luxe Kering -qui possède les marques Gucci, Saint-Laurent, Alexander Mc Queen, le joailler Boucheron ou encore l’équipementier sportif Puma-, le fournisseur d’énergie Engie (ex-GDF Suez) ou encore deux « Gafam » (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft) sans préciser l’identité de ces deux géants américains du numérique.
Absentes il y a 5 ans, les entreprises étrangères -américaines surtout- génèrent désormais 20% des revenus d’Equinix France.

Le datacenter PA4 d'Equinix à Pantin, dans le nord-est de Paris.
Dans un angle du vaste hall d’accueil, notre hôte déverrouille une porte blindée -grâce à l’empreinte de sa main et à un badge- puis une seconde, avant de nous faire entrer dans un immense couloir rectiligne et vide, seulement ponctué de canalisations larges comme des troncs d’arbres, qui grimpent jusqu’au plafond aux abords de chaque salle.
N’imaginez pas y entrer sans une nouvelle identification biométrique. « Sept points de contrôle doivent être franchis pour accéder à un serveur. » L’enjeu : protéger le réacteur de la vie numérique des clients. Si leurs serveurs venaient à s’arrêter, leurs sites internet et leurs données deviendraient inaccessibles, ce qui les effacerait du monde virtuel dans l’instant. Une apocalypse numérique qui leur ferait perdre des sommes colossales.
Pour anticiper ce risque, nombre d’entre elles installent des serveurs de secours dans l’un des sept autres sites d’Equinix, qui sont tous reliés les uns aux autres et disposent au total d’une capacité d’hébergement de 55.000 m2. « Le risque de perte ou de vol de données est infime dans nos murs mais subsiste quand elles transitent sur le réseau, à la merci des hackers. »
A première vue, toutes les salles se ressemblent, avec leurs enfilades de baies, ces armoires où s’empilent les serveurs. Mais chacune a sa propre histoire. Certaines accueillent un client unique, comme Criteo, qui a fait peindre sa salle en orange et l’a entourée de panneaux métalliques noirs occultants, à l’abri des regards du voisinage. D’autres, aux tons gris neutres, abritent plusieurs entreprises, séparées par un grillage.
Dans cette colocation informatique, la discrétion fait loi, et on ne connait pas toujours l’identité de son voisin. « La plupart des clients ne personnalisent pas leurs baies, pour garder leurs choix de matériels secrets ». Ici, un adepte du rangement au cordeau a choisi un matériel uniforme et a aligné avec soin des câbles d’une seule et même couleur, tandis que chez son voisin, des câbles bariolés et enchevêtrés forment un arc-en-ciel chiffonné. « Aucun client n’a jamais demandé à choisir son emplacement. Nous veillons cependant à ne pas réunir deux Gafam dans une même salle. »
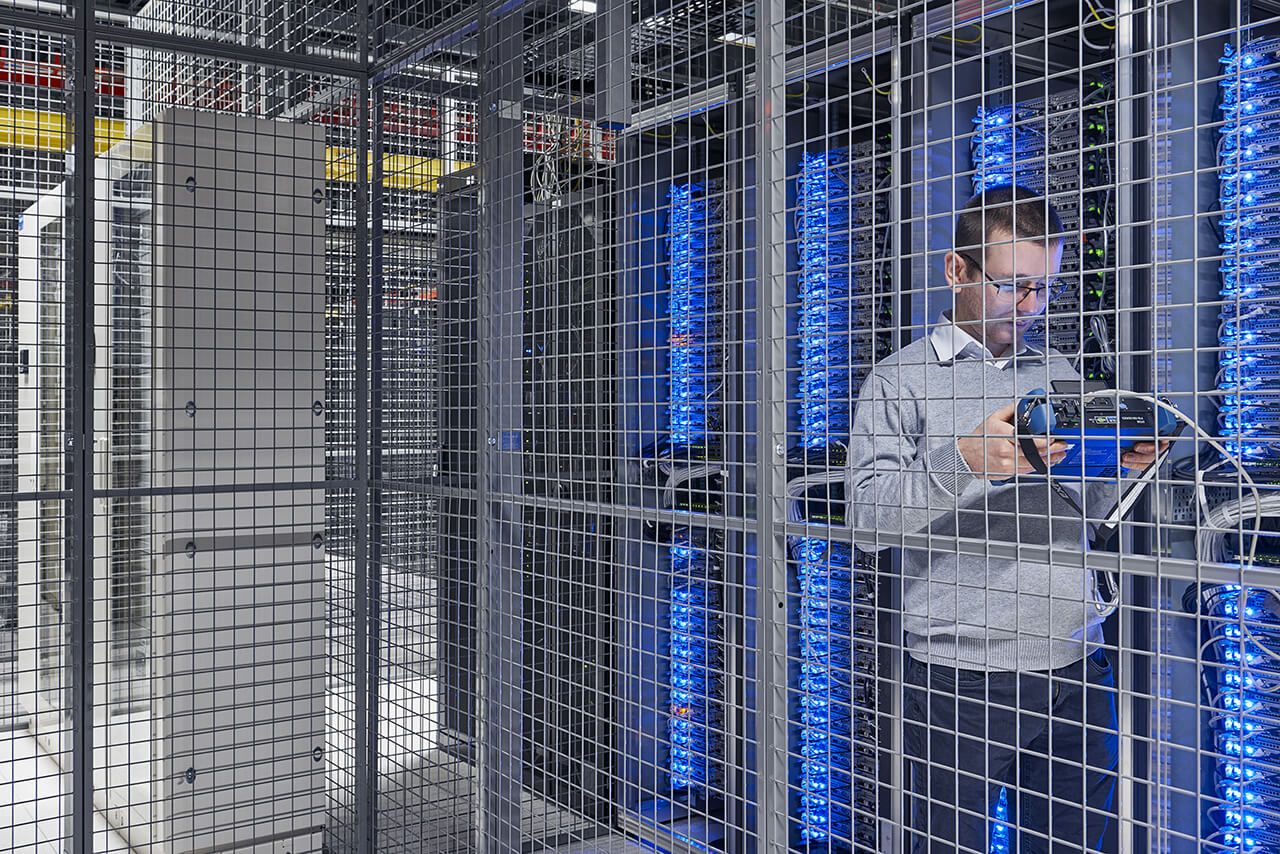
Dans tous les datacenters, la température d'une salle est maintenue à 24 degrés.
La climatisation vrombit à plein volume pour diffuser un puissant souffle à 13 degrés. En effet, s’ils n’étaient pas constamment refroidis par cet air venu du toit, les serveurs pourraient être endommagés par la chaleur produite par leur fonctionnement. L’arrivée d’air frais est matérialisée au sol par des lumières bleues, et l’évacuation de la chaleur par des leds rouges.
« La température d’une salle est maintenue à 24 degrés dans tous les datacenters. Mais ce seuil pourrait être relevé à 30 degrés sans nuisances. Nous essayons d’expliquer à nos clients que ces quelques degrés de plus dans les salles permettent de lutter contre le réchauffement climatique. » Les datacenters d’Equinix consomment en effet autant d’électricité qu’une ville de 150.000 habitants.
« Notre industrie se montre créative pour réduire son empreinte écologique : certains datacenters récupèrent la chaleur des serveurs pour chauffer des piscines, d’autres s’installent au Pôle Nord pour disposer d’un refroidissement naturel. Le datacenter d’Equinix à Amsterdam fonctionne même uniquement grâce à la géothermie. En France, les énergies renouvelables ne sont pas encore assez performantes pour nos usages. Mais nous avons conclu un accord avec EDF pour que chaque euro d’électricité nucléaire que nous consommons soit réinvesti dans le développement des énergies vertes. »
Des salariés d’EDF, spécialistes de la haute tension, travaillent en permanence dans les datacenters, aux côtés des ingénieurs et techniciens d’Equinix. Ces équipes se relaient pour assurer une présence sur le site 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Depuis quelques années, Equinix France a recruté de nouveaux profils (marketing, fonctions support), notamment des femmes. Il compte désormais près de 200 salariés, pour la plupart des hommes jeunes qui habitent dans les environs, à Pantin ou à Aubervilliers.

Les équipes d'Equinix se relaient pour assurer une présence sur le site 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
« En presque 20 ans d’existence, notre métier a évolué. Dans les années 1990, nous étions considérés comme un simple bâtiment de stockage, puis nous sommes devenus le partenaire de la mutation digitale des entreprises, et aujourd’hui nous animons l’écosystème numérique en mettant en relation nos clients entre eux, selon leurs besoins. »
Entremetteur dans le monde virtuel, le datacenter sait aussi se faire rampe de lancement pour des vocations d’avenir. Il a ainsi accueilli en mai 2016 un groupe de jeunes adolescents réunis par une association sociale. Venus découvrir les secrets du lieu, certains y ont trouvé leur voie professionnelle et l’idée de leur futur métier. Quand ils arriveront sur le marché du travail, l’activité des datacenters aura sans doute décuplé, portée par l’essor des objets connectés et l’émergence de l’intelligence artificielle.
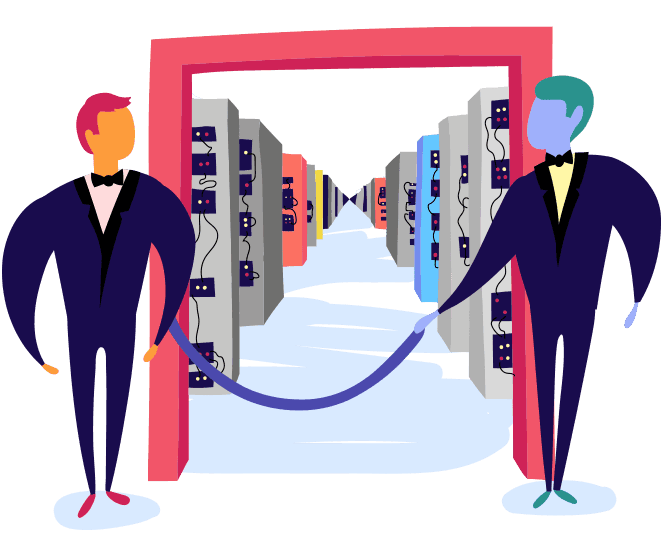
Un smartphone dans le cartable ?
Votre enfant réclame un téléphone, et souligne que tous ses copains en ont un (eux !). Si vous vous demandez à quel âge il est sage d’accéder à cette demande, voici quelques faits susceptibles de vous aider à prendre une décision d’ici à la rentrée.
Cartable, trousse, cahiers… et téléphone ! Il ne figure pas sur la liste du matériel scolaire à acquérir à chaque rentrée, mais le portable sera bien présent à l’école. La loi interdit son usage dans les salles de classe, tout en autorisant la réception d’appels et de messages pendant la récréation. Et bien qu’Emmanuel Macron ait fait part pendant la campagne présidentielle de son intention de le bannir des établissements scolaires, le règlement restera inchangé.
Ainsi, on estime que huit collégiens français sur dix l’auront en poche en septembre prochain. Le taux d’équipement a même été multiplié par 4 entre 2011 et 2015, selon le Crédoc. Dans certains collèges, on compte désormais les élèves sans portable sur les doigts d’une seule main. A l’âge où les adolescents travaillent autant leurs cours que leur style, le téléphone est devenu aussi incontournable que les baskets -pardon : les « sneakers » !- à la mode. Et les écoliers de primaire commencent à suivre cette tendance : sur dix élèves de CM1-CM2, un possède un téléphone, et deux autres un smartphone connecté à internet.
Vous songez peut-être que « c’est un peu tôt ». La moitié des Français estime que le « bon âge » pour recevoir son premier téléphone se situe entre 10 et 13 ans, c’est-à-dire à l’entrée au collège1. Pour autant, de nombreux parents hésitent au moment de réaliser cet achat.
Manque de sommeil et baisse de la concentration
Plusieurs études pointent les méfaits sur le développement du cerveau provoqués par les écrans en général, et les smartphones et tablettes en particulier. Par exemple, la lumière bleue qu’ils émettent trouble l’endormissement. Or, les jeunes utilisateurs, plus encore que leurs aînés, attrapent leur smartphone dès le réveil, et l’ont encore en main quand ils se couchent. Ils passent en moyenne six heures par jour face à un écran (d’ordinateur, de téléphone ou de télévision)2, soit trois fois la limite conseillée au niveau international. Leur sommeil perturbé nuit à leur croissance et l’attention en classe se relâche.
Parmi les 130 000 élèves de 91 lycées britanniques suivis par des chercheurs de la London School of Economics, ceux qui fréquentaient des établissements ayant banni le téléphone obtenaient de meilleurs résultats, quand ceux qui cumulaient smartphone et difficultés scolaires voyaient leurs notes chuter encore davantage.
Le danger serait plus grand chez les petits : les enfants de moins de deux ans qui jouent quotidiennement pendant plus d’une demi-heure avec un smartphone ou une tablette présenteraient des troubles du langage, seraient moins compétents à résoudre des problèmes peu complexes, et témoigneraient moins d’empathie3.
En France, le docteur Anne-Lise Ducanda, de la protection maternelle et infantile dans l’Essonne, affirme que l’exposition aux écrans avant l’âge de quatre ans favorise les troubles autistiques. « Ce sont des enfants dans leur bulle, indifférents au monde qui les entoure, qui souvent ne réagissent pas à leur prénom, qui ne jouent pas avec les autres. » Selon elle, un enfant sur vingt serait concerné dans notre pays.
Le blues des réseaux sociaux
Chez les adolescents, les risques se cristallisent sur les réseaux sociaux. La pseudo-réalité qui s’y étale contribuerait ainsi à complexer des jeunes déjà en proie aux affres de la puberté, jusqu’à menacer leur santé mentale. Au Canada, selon les services de santé de la ville d’Ottawa, un quart des 750 lycéens et étudiants qu’ils ont observés manifestait une détresse psychologique voire des pensées suicidaires dès lors que ces derniers passaient plus de deux heures par jour sur les réseaux sociaux. Les esprits les plus vulnérables seraient en effet plus enclins à y chercher un réconfort.
Mais sur internet comme dans la ville, la bienveillance côtoie la violence. Le cyber-harcèlement, initié par des inconnus ou des « camarades » de classe, serait la cause de 3 à 4 suicides par an en France, principalement chez les jeunes de 12 à 13 ans, avait confié Justine Atlan, la présidente de l’association de prévention e-Enfance, à L’Express en mai 2014.
La meilleure façon d’apprendre
A la lecture de ces faits, tout parent serait tenté de répondre à son enfant réclamant de posséder son propre téléphone portable : « passe ton bac d’abord ! ». Mais le pédopsychiatre Marcel Rufo défend cette « encyclopédie » accessible du bout des doigts, qui ouvre une fenêtre sur le monde pour se construire et s’affirmer.
L’outil s’avère même un pédagogue efficace. Par exemple, en 2013 à Gréasque, dans les Bouches-du-Rhône, des élèves de sixième se sont appliqués à concevoir une application touristique qui mobilisait différents apprentissages : les recherches qu’ils ont menées les ont plongés dans l’histoire locale, puis ils ont construit une narration comme appris en cours de français, qu’ils ont traduite en anglais, tout en ajoutant des chants pastoraux orchestrés par leur professeur de musique. Ce projet leur a permis de donner du sens à un corpus d’enseignements parfois abscons et en apparence décousus, et d’éprouver la fierté de la mission menée à son terme.
A travers l’Hexagone, de plus en plus d’enseignants recourent au téléphone pour illustrer des concepts abstraits : mesurer la vitesse d’un ascenseur en physique ; étudier le comportement des oiseaux face au bruit en biologie ; ou encore pour un exercice de traduction bilingue quand ils ne disposent que de deux dictionnaires pour 30 élèves.
Se former dès à présent aux métiers qui n’existent pas encore
Quand la génération actuellement à l’école arrivera sur le marché du travail, elle briguera des emplois qui n’existent pas encore. La mutation numérique de l’économie est en effet loin d’être achevée. D’ores-et-déjà, les grands groupes et les start-up plébiscitent les « digital natives ». Ayant grandi avec Internet et les écrans, ils ont une approche différente et plus innée de la technologie.
L’Education nationale a lancé un investissement d’un milliard d’euros sur trois ans pour permettre à tous les jeunes de prendre ce train du numérique en marche. Lors de l’année scolaire 2017-2018, ce sont donc 600 000 élèves qui devraient avoir accès à un outil numérique (ordinateur ou tablette) individuel ou collectif, soit trois fois plus que l’année précédente.
Mais pour maîtriser pleinement le numérique, il faut aussi apprendre… à s’en passer. Au Royaume-Uni, le collège-lycée pour filles de Gloucestershire a ainsi expérimenté en juillet dernier une semaine de « digital detox », pendant laquelle les élèves ont vu leur téléphone banni de l’école comme de la maison, où il n’a jamais sa place à table, ni pendant les devoirs.
Une expérience similaire a été menée avec les élèves de CM1-CM2 de l’école primaire Manin, dans le 19e arrondissement de Paris. Passé les craintes et la déception initiales, les 23 élèves qui s’étaient tenus éloignés de tous les écrans pendant sept jours ont déclaré être ravis d’avoir relevé le défi.
Décrocher, c’est la clé !
Savoir se détacher du « doudou » numérique est indispensable pour se prémunir d’une dépendance et des angoisses de manque (symptômes de la « nomophobie »), mais aussi utile pour que les professeurs puissent évaluer le niveau des élèves sans biais. En effet, il arrive que certains tricheurs prétextent un besoin urgent pour quitter la salle d’examen et pouvoir consulter leurs antisèches sur leur téléphone. La solution pourrait avoir été trouvée du côté de l’Ecole nouvelle de Lausanne, où les élèves acceptent de confier leur « précieux » au bibliothécaire -et par ailleurs doyen- dès lors qu’ils pénètrent dans l’établissement.
L’Académie des Sciences4 préconise d’« adapter la pédagogie à l’âge de l’enfant et [de] lui apprendre l’autorégulation ». Rien n’oblige donc à adopter la méthode en vigueur dans la ville de Guiyang, dans le sud de la Chine : chaque élève chinois qui enfreint l’interdiction du téléphone à l’école voit sa possession détruite à coups de marteau, après avoir été plongée dans l’eau, sous les yeux de tous ses camarades. La portée pédagogique d’une telle « exécution publique » laisse songeur.
Quel que soit son âge, un enfant apprend en effet d’abord par imitation. Or, un enfant sur trois interrogés par AVG Technologies5 a déclaré qu’il se sentait parfois délaissé par ses parents quand ceux-ci… sont occupés à consulter leur smartphone, notamment pendant les repas ! Ils estiment ne pas recevoir le bon exemple, et rêveraient de confisquer le portable parental s’ils le pouvaient. Du point de vue de l’enfant, le meilleur moment pour recevoir son premier téléphone coïncide sans doute avec celui où son parent est prêt à décrocher du sien.
1 Selon le sondage « Les Français et l’éducation des enfants » réalisé en février 2015 par l’Observatoire de la vie quotidienne des Français BVA-Domeo-Presse Régionale.
2 Enquête internationale « health behaviour in school-aged children », 2016. Ce sondage est réalisé tous les quatre ans dans 40 pays auprès de jeunes de 11 à 15 ans.
3 Etude réalisée avec 890 enfants de 6 à 24 mois et présentée en mai 2017 lors du Colloque des Sociétés académiques américaines de Pédiatrie.
4 « L’Enfant et les écrans », par François Bach, Olivier Houdé, Pierre Léna et Serge Tisseron, Editions Le Pommier, 2013. Cet avis a été remis à plusieurs ministères.
5 Enquête réalisée en juin 2015 auprès de 6000 enfants de 8 à 13 ans de différents pays, dont la France.

Smart city : la ville plus facile à vivre grâce aux données ?
Les objets connectés et Internet transforment les organisations urbaines, pour rendre les villes plus écologiques et plus agréables au quotidien. Une transformation qui se bâtit grâce aux données des citoyens.
Imaginez-vous consultant les informations en 2051. Voici ce que vous pourriez lire :
« L’année débute sur un constat enthousiaste : Paris a relevé son défi et rejoint le club des villes à zéro émission de carbone. Que de progrès depuis trente ans ! Les 2,4 millions d’habitants de la Ville Lumière ont pris l’habitude de voir les lampadaires dans les rues s’allumer à leur approche, et s’éteindre peu après leur passage. La smart city parisienne a ainsi réduit d’un tiers la consommation énergétique de l’éclairage urbain.
Chaque logement produit de l’électricité grâce à des panneaux solaires ou des éoliennes domestiques, et fait commerce de celle-ci avec ses voisins. Les embouteillages et les pics de pollution record des années 2020 ont été relégués aux oubliettes.
Désormais, le citadin télétravaille la plupart du temps et quand il doit se déplacer, il emprunte systématiquement les transports en commun ou un véhicule partagé. Et pourquoi s’en priverait-il ? Il est devenu tellement simple de demander à son assistant vocal virtuel de localiser une voiture disponible et de la réserver, ceci après avoir consulté le tarif de location proposé par le particulier qui la possède ! Le véhicule sans chauffeur permet de vaquer à ses occupations pendant le trajet, comme relire une présentation ou échanger avec les autres co-voyageurs. Arrivée à destination, la voiture se gare toute seule sur la place de parking qui lui a été désignée.
Comme sur ce lieu de stationnement, des dizaines de milliards d’objets connectés communiquent entre eux, sans intervention humaine, pour optimiser la vie urbaine quotidienne tout en préservant les ressources.
Grâce à la blockchain, le paiement des services utilisés est devenu automatique, sûr et désintermédié : plus besoin des banques pour enregistrer et certifier les transactions, qui se font désormais entre particuliers. Les porte-monnaie sont désuets : il suffit de présenter sa montre connectée pour acheter les fruits et légumes produits par la ferme urbaine installée sur les toits du quartier.
Vos boutiques préférées conservent votre historique d’achats et s’intéressent à vos réactions sur les réseaux sociaux pour vous adresser des coupons de réduction sur les produits dont vous avez besoin. Un repas commandé auprès d’un restaurant de la ville est livré à votre domicile grâce à un drone solaire.
Les entreprises innovantes des années 2010 - notamment le service de transport Uber, le loueur d’appartements Airbnb ou le livreur à domicile Foodora - ont disparu depuis belle lurette, et les politiques publiques ont changé de visage ! Désormais, les citoyens ont délaissé les élections pour se prononcer en continu sur chaque mesure proposée par les partis politiques et construite sur les calculs d’impact de leur intelligence artificielle. Grâce aux données récoltées et analysées en masse, tout paraît plus simple. »
L’avenir est déjà là
Qu’elle vous séduise ou non, cette ville futuriste, écologique, connectée et régie par les données émerge déjà sur tous les continents. Dès 2014, Barcelone a mis en place un système de régulation de l’éclairage public, fonctionnant par LED. Singapour a implanté des Supertrees (« super arbres ») hauts de 50 mètres pour éclairer les rues, recueillir les eaux de pluie et modérer la température. A Songdo, en Corée du Sud, les routes et les bâtiments construits selon les standards de haute qualité environnementale sont équipés de capteurs permettant de réguler le trafic et la consommation d’énergie. A Los Angeles, les bennes à ordures partagent automatiquement leur niveau de remplissage pour optimiser la tournée des éboueurs. En Israël, Tel Aviv propose une application pour signaler les nids de poules sur la chaussée et permettre leur réparation rapide. En Allemagne, enfin, le fournisseur d’énergie RWE a mis en place un système de paiement par la blockchain sur une centaine de bornes de rechargement pour voiture électrique.
La collecte et l’analyse des données changent aussi le visage des villes en France : grâce à elles, Lyon expérimente des bâtiments à énergie positive et un réseau de véhicules en libre-service dans l’éco-quartier Confluence, et traque les fuites sur l’ensemble de son réseau d’eau potable. Paris régule le trafic autour de la place de la Nation pour réduire la pollution et le bruit.
Les expérimentations sont légion dans les grandes métropoles comme dans les villes moyennes. Montpellier, Dijon, Clermont-Ferrand et Nantes figurent parmi les 70 villes moyennes les plus intelligentes sur 1600 étudiées en Europe par le chercheur viennois Rudolf Giffinger. Derrière les leaders du palmarès général - qui sont Danoises, Autrichiennes et Finlandaises - les Françaises excellent en matière de préservation de l’environnement.
Garder le contrôle sur les données
Devenir une smart city est désormais incontournable : deux tiers de la population mondiale vivra en ville sous trente ans, contre la moitié aujourd’hui. Or, les territoires urbains émettent 80% des gaz à effets de serre, alors qu’ils ne couvrent que 2% de la surface de la planète.
La technologie peut aider à répondre à cet enjeu, mais pose la question de l’utilisation des données personnelles. La loi européenne de protection des données, qui entrera en vigueur dès l’année prochaine, en encadre plus strictement encore l’usage, et permet à chaque consommateur et citoyen d’avoir un droit de regard sur l’utilisation qui est faite de ses données. Les organismes publics en collectent eux aussi, sur leurs propres serveurs, et doivent missionner un délégué à la protection des données personnelles pour veiller à leur protection.
Cette mesure apparaît suffisante pour la plupart des observateurs, qui arguent que les villes intelligentes ne traitent que des données anonymes. Une voix dissonante s’est toutefois faite entendre en 2016 : Rob Kitchin, chercheur à l’Université irlandaise de Maynooth, soulignait alors que les données sont rarement anonymes mais plutôt « pseudonymisées », ce qui rend le processus réversible. Autrement dit, votre identité peut être retrouvée.
Le chercheur attirait l’attention sur le fait que les villes intelligentes ont aujourd’hui peu l’habitude de requérir le consentement des citoyens dont elles intègrent les données. Dans un état démocratique transparent, l’impact est limité. Il avertit en revanche que ce système de collecte des données pourrait être préjudiciable si une puissance publique décidait de les utiliser pour prédire des crimes ou pour lutter contre le terrorisme.
Rob Kitchin recommande que tous les Etats définissent le caractère privé de la donnée comme fondamental – à l’instar de l’Union européenne – et que la puissance publique se charge d’informer les consommateurs-citoyens des enjeux liés à la donnée. Pour que l’accès au monde paradisiaque des villes intelligentes ne se fasse pas au prix des libertés individuelles.

Laurent Alexandre, l'agitateur d'intelligence
Cet énarque-chirurgien est le vulgarisateur en France de l’intelligence artificielle et des défis qu’elle pose. Portrait.
Le « Slasheur 1 clasheur 2 » : si le débat intellectuel était un ring, ce nom lui irait comme un gant. A 57 ans, Laurent Alexandre ne mâche pas ses mots pour exprimer ses opinions sous l’une de ses nombreuses casquettes : docteur en urologie, entrepreneur en série, « business angel », essayiste, conférencier ou encore romancier. Fondateur du site Doctissimo.fr, qu’il a revendu à Lagardère en 2008, il est aujourd’hui le principal évangélisateur de l’intelligence artificielle en France.
« Nous sommes dix tout au plus à intervenir sur ce sujet », regrette-t-il. Dans son dernier essai, La Guerre des Intelligences 3, qui s’est déjà écoulé à 60.000 exemplaires trois mois après sa parution, il prône une réforme en profondeur de notre système éducatif et de la pédagogie de l’enseignement pour permettre aux jeunes de trouver leur place dans le monde d’après 2030, où les emplois peu qualifiés seront remplacés par des robots et des algorithmes auto-apprenants.
Cet énarque, passé par Sciences Po’ et par un MBA à HEC, estime que même les grandes écoles prestigieuses ne sont plus dans le coup pour former les jeunes à « apprendre à apprendre » : « La plupart des métiers de demain n’existent pas encore. Mais ce qu’on sait déjà, c’est qu’il n’y aura plus de postes pour les humains avec un quotient intellectuel inférieur à 120 ».
Un progressiste sociétal féru de nouvelles technologies
Sur le réseau social Twitter, où ce passionné de nouvelles technologies intervient chaque jour avec un vocabulaire parfois fleuri 4, certains l’accusent d’alarmisme prématuré et caricatural. Pas de quoi le vexer, au contraire : il préfère la critique à l’indifférence. Il avait d’ailleurs espéré que la sortie de son essai suscite le débat chez les enseignants : « Je m’attendais à ce qu’on me rentre dedans. Mais non, rien. Plutôt que de lire et de repenser la pédagogie, certains syndicats préfèrent sélectionner les participants à leurs réunions en fonction de leur couleur de peau ! Cette attitude me révulse !»
Militant du progrès sociétal, il a subi les foudres de la « Manif pour tous » pendant des mois. Sans ciller. Le seul reproche qui peut l’atteindre est celui d’arrogance. Il s’efforce de contenir sa rapidité d’esprit, mais parfois sa réponse précède la fin de la question de son interlocuteur, et son argumentation dense et détaillée peut paraître professorale. De tels quiproquos sont communs dans la vie des génies. Laurent Alexandre aurait un QI très élevé (entre 140 et 180) mais il se montre pudique et taiseux sur ce point.
Pour lui, le transhumanisme n’est pas une option
On le dit adepte de la philosophie transhumaniste, ce qu’il réfute. « Je ne suis pas partisan, j’observe simplement les évolutions en cours. L’homme augmenté ne sera pas un débat sociétal, mais une nécessité pour éviter une révolution d’ici à 2050 », prophétise-t-il.
Pour lui, les générations futures se rueront sans complexe sur les greffes technologiques qui permettront d’accroître les capacités physiques et intellectuelles humaines. « Mes enfants se montrent beaucoup moins conservateurs que moi sur cette question. Ils ne comprennent pas pourquoi j’hésite face à l’idée d’implanter des puces dans nos cerveaux, car ils sont convaincus que la réponse aux défis posés par la technologie viendra de la technologie. »
Eveilleur de consciences sans frontières
Libéral de centre-gauche, il a rencontré les ministres à qui il a dédicacé son dernier essai : Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Education qu’il renomme « Ministre de l’Intelligence Biologique », et Mounir Mahjoubi, le secrétaire d’Etat chargé du Numérique, qui devient sous sa plume le « Ministre de l’Intelligence Artificielle ».
Laurent Alexandre se garde pour autant de donner des leçons ou de souffler des mesures. Il dresse un constat, et tire la sonnette d’alarme, chiffres à l’appui. « Nous sommes engagés dans une guerre technologique que nous refusons de voir, et que nous avons déjà perdue : la France et l’Europe sont devenues les colonies numériques des GAFAM (i.e. les entreprises américaines Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) et des BATX (i.e. les entreprises chinoises Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi). Nous n’investissons pas assez dans l’intelligence artificielle.
L’Inria, qui est le fer de lance de la recherche française en la matière, voit depuis des années son budget stagner à 230 millions d’euros par an, alors que l’américain Intel a déboursé 15,3 milliards de dollars en 2017 pour le seul rachat de MobilEye, une start-up israélienne du secteur. Au niveau européen, le programme Human Brain Project (pour modéliser et reproduire le fonctionnement du cerveau humain dans un réseau de neurones artificiel, NDLR) dispose d’1 milliard d’euros pour dix ans de recherches, tandis qu’Amazon investit chaque année 15 milliards de dollars dans son effort d’innovation. Si nous ne réagissons pas sans tarder, la France sera un pays du Tiers-Monde en 2080. »
L’immortalité dans un robot ? Non merci !
Il met du cœur et de la fougue dans son action de sensibilisation aux défis à venir : il donne des interviews et rédige des chroniques dans différents médias, les vidéos de ses interventions - notamment devant le Sénat en 2013 - enregistrent des millions de vues, et il donne plus de 100 conférences par an en France et à l’étranger. « Ce qui m’intéresse, c’est le débat autour des évolutions du travail qui seront engendrées par l’intelligence artificielle, même si je n’en verrai que les débuts ».
Gastronome, le docteur Laurent Alexandre n’est pas du genre à rêver de l’immortalité passée à l’intérieur d’un clone robotique. « Ceux qui prétendent aujourd’hui pouvoir transférer le contenu d’un cerveau humain dans un ordinateur sont des illusionnistes. Je serai mort depuis longtemps quand cette technologie sera disponible… si elle l’est un jour. » Et de toute façon, cette promesse ne l’intéresse pas.
1 « slasheur » : nom inspiré de l’anglais (« slash » étant en anglais le nom du signe de ponctuation que nous appelons « barre oblique » ou « barre de fraction ») et apparu en 2016 pour désigner les personnes qui ont plusieurs activités professionnelles en même temps.
2 « clasher » : verbe issu de l’anglais désignant le fait de provoquer quelqu’un verbalement, de lancer une polémique.
3 Alexandre Laurent, La Guerre des Intelligences, JC Lattès, Paris, octobre 2017.
4 Voir @dr_l_alexandre sur Twitter.
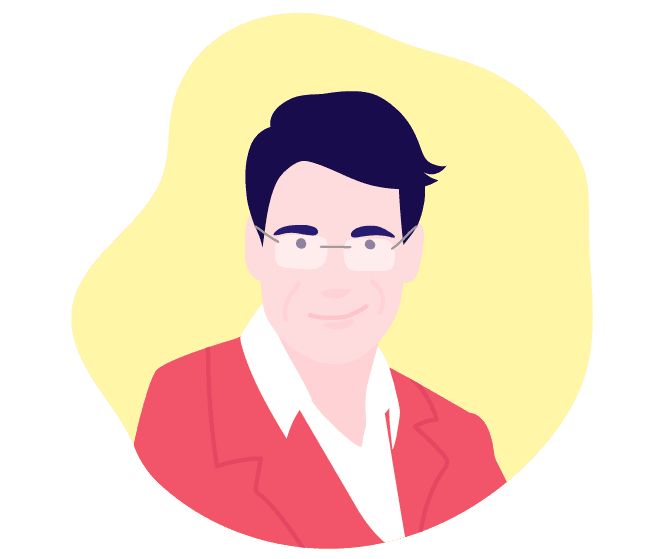
Demain, tous crétins ?
Selon une étude scientifique, le quotient intellectuel des Français aurait régressé à la fin du XXe siècle. Si certains estiment que les technologies numériques risquent de nous abêtir, d’autres y voient une opportunité d’accroître notre intelligence.
En dix ans, nous avons perdu 3,8 points de quotient intellectuel moyen, qui s’établit désormais à 97,3 1. Ce chiffre, avancé en 2015 par Edward Dutton et Richard Lynn, est issu d’une étude menée en France auprès d’un échantillon de 79 personnes, évaluées en 1998-1999 puis en 2008-2009. L’anthropologue et le psychologue observaient alors pour la première fois cette régression dans notre pays, ainsi qu’en Australie, aux Pays-Bas, en Suède, en Finlande, tandis qu’ils constataient une augmentation du QI des Hongkongais et des Singapouriens (à 108, soit dix points de plus que le QI moyen français).
Des causes multiples
Leur étude a fait l’effet d’un coup de semonce. Pour autant, le mythe d’une croissance infinie de l’intelligence humaine avait déjà été brisé : le chercheur James Robert Flynn avait constaté une baisse de QI au Royaume-Uni dès le milieu des années 1990. Cet « effet Flynn » a ensuite été observé au Danemark puis en Norvège.
Les capacités intellectuelles humaines ne progressent plus, alors qu’elles s’étaient développées de façon constante grâce à l’amélioration de notre alimentation, de notre éducation et de nos conditions de vie 2, depuis la création en 1939 de l’échelle de Wechsler - le test de QI le plus souvent employé. L’observation de cet « effet Flynn » en France a inquiété d’autant plus que des algorithmes auto-apprenants ont fait leur apparition, ouvrant la voie à la construction de machines intelligentes capables à l’avenir de remplacer les humains dans divers métiers.
La cause de l’érosion de notre QI reste mystérieuse. Certains accusent les substances chimiques nocives (perturbateurs endocriniens notamment) qui se sont multipliées dans notre environnement.
S’appuyant sur une étude britannique 3, le docteur Laurent Alexandre souligne quant à lui l’impact de notre mode de vie : le quotient intellectuel est en majeure partie déterminé par la génétique. Or, les statistiques montrent que les femmes les plus intelligentes travaillent davantage et font moins d’enfants, ne contribuant dès lors pas à faire progresser le quotient intellectuel moyen de la population.
Edward Dutton et Richard Lynn incriminent pour leur part l’abandon de la lecture – notamment de littérature – au profit d’autres formes de médias, non imprimés, pour expliquer la moindre richesse du vocabulaire des Français (qui est le critère de mesure du QI qui affichait le repli le plus important : -4 points).
Le numérique, un risque de plus ?
Le numérique serait la cause d’une intensification du risque de baisse du QI pour la génération dernière-née. Selon la pédo-psychologue canadienne Linda Pagani, les enfants de moins de 2 ans et demi exposés aux écrans plus d’une heure par jour verraient leurs compétences en mathématiques réduites de moitié dès la classe de CM2.
Dans une vidéo publiée sur YouTube en mars 2017, la médecin Anne-Lise Ducanda alerte les parents et les pouvoirs publics sur certains retards irrémédiables du développement cognitif : selon elle, les tout-petits qui manient des écrans plus de trente minutes chaque jour parleraient plus tardivement que les enfants qui en sont tenus à l’écart. Certains d’entre eux présenteraient même des troubles du spectre autistique : ils ne réagissent pas à leur prénom, ils répètent mot pour mot les phrases qu’ils entendent sans y répondre, ils peinent à se concentrer et s’agitent ou au contraire, se montrent apathiques.
Le GPS et le smartphone mis à l’index
Chez les adultes également, l’usage régulier des technologies numériques a tendance à réduire certaines capacités cérébrales. En 2010, Véronique Bohbot, chercheure en neurosciences à l’Université canadienne McGill, a comparé les capacités de mémorisation et de représentation dans l’espace de deux groupes de chauffeurs de taxis, le premier s’orientant avec un GPS et le second se dispensant de cette technologie.
Chez les utilisateurs de l’assistant de navigation, l’étude a démontré une activité réduite de l’hippocampe, la partie du cerveau qui pilote notre mémoire et notre orientation spatiale, première zone cérébrale impactée par la maladie d’Alzheimer.
Le smartphone a quant à lui été montré du doigt par le professeur Kostandin Kushlev. En mai 2016, ce chercheur américain en psychologie sociale et comportementale de l’Université de Virginie a suivi 221 étudiants du campus. L’étude démontre alors que l’utilisation intensive des smartphones engendrait des symptômes semblables à ceux du « trouble du déficit de l’attention ». Les participants à l’étude développaient en effet des difficultés de concentration au bout d’une semaine, dès lors qu’ils activaient toutes les notifications et rappels sonores permis par l’appareil, et qu’ils consultaient chacune d’entre elles.
Et si on augmentait nos cerveaux ?
Au-delà des risques liés aux usages excessifs ou inadaptés, le numérique pourrait offrir une solution pour pallier la baisse de l’intelligence humaine. Pour les curieux, Internet facilite la découverte et la connaissance. Depuis 2011, les « Mooc » (pour « massive open online courses ») se multiplient. Ces cours en ligne en accès libre permettent à chacun de se former aux thématiques de son choix, souvent gratuitement. Selon Class Central qui répertorie ces Mooc, 7000 universités à travers le monde proposaient des cours en ligne fin 2016, alors suivis par près de 58 millions de personnes.
Grâce aux neurosciences cognitives, les technologies numériques pourraient également nous aider à apprendre plus facilement, et donc davantage. Ce nouveau champ de connaissance scientifique est apparu depuis une trentaine d’années seulement, grâce au traitement de données et la modélisation informatisés, combinés à la psychologie expérimentale et à l’imagerie cérébrale. Il étudie le fonctionnement du cerveau en vue de faciliter l’acquisition de connaissances pour chacun.
Les experts de ce domaine promettent une révolution éducative à l’école : dans les prochaines années, des stratégies d’apprentissage personnalisées remplaceraient la pédagogie universelle – dont les résultats sont contestés aujourd’hui. Le ministre de l’Education nationale planche d’ores et déjà sur l’intégration des neurosciences à la formation des enseignants. En septembre dernier, Jean-Michel Blanquer a ainsi confié à Stanislas Dehaenne – professeur en psychologie cognitive expérimentale au Collège de France – la direction d’un comité scientifique chargé de plancher sur ce sujet et sur les disciplines enseignées dans les classes.
Mais d’autres travaillent à une solution plus radicale : augmenter les capacités intellectuelles humaines en reliant notre cerveau à un ordinateur. Cette ambition – qui relève aujourd’hui de la pure science-fiction – draine des centaines de millions d’euros d’investissement.
Neuralink, l’entreprise fondée par le milliardaire américain Elon Musk, vise ainsi à mettre au point un implant cérébral qui connecterait nos neurones à la puissance de calcul informatique : « nous sommes déjà des cyborgs. Votre téléphone et votre ordinateur sont des extensions de vous-même, mais l’interface se fait via les mouvements des doigts ou par la voix », détallait-il au magazine américain Vanity Fair en février dernier, précisant que cette interaction était selon lui trop lente. Il estime que nous gagnerions en temps et en intelligence si nous pouvions transmettre instantanément notre pensée à un ordinateur, et recevoir sa réponse tout aussi vite.
Entre piratage et eugénisme, ce projet fait débat. Jusqu’à présent, les premières implantations de puces informatiques dans des cerveaux humains ne visent qu’à réparer des fonctions défaillantes : deux tétraplégiques américains, Ian Burkhart et Nathan Copeland, ont ainsi pu retrouver l’usage d’une main et le sens du toucher. Mais aussi futuriste qu’elle paraisse, cette technologie d’ « augmentation cérébrale » pourrait devenir une nécessité dans les prochaines décennies.
Laurent Alexandre estime ainsi qu’elle sera la seule option quand l’intelligence artificielle sera arrivée à maturité. Il parie même que la pose d’implant sera peu chère, voire financée par l’Etat, pour éviter une révolution dans un monde où seuls les QI les plus élevés pourront trouver un emploi. Mais nous disposons sans doute encore de quelques décennies pour y réfléchir.
1 Dutton Edward et Lynn Richard, « A negative Flynn Effect in France, 1999 to 2008-9 », Intelligence n°51, Elsevier, 2015.
2 Flynn James Robert, « Are we getting smarter? Rising IQ in the twenty first century », Cambridge University Press, 2012.
3 « Les femmes douées font moins d’enfants », tribune de Laurent Alexandre, publiée dans L’Express, le 31 janvier 2018.

Et si la blockchain ringardisait la carte bancaire...
Cette technologie numérique fait couler de l’encre, alimentant les fantasmes d’un monde sans banque ni aucun intermédiaire. Des initiatives sont lancées pour tester cette méthode révolutionnaire d’enregistrement des transactions
Alors que la France rechigne à abandonner le chèque, une technologie émergente se voit déjà reléguer la carte bancaire aux oubliettes. Cette nouvelle méthode d’enregistrement des transactions -la « blockchain »- est entièrement dématérialisée et propose de se passer d’intermédiaires pour valider l’échange en offrant la traçabilité de toutes les opérations.
Les esprits enthousiastes imaginent déjà un avenir où les billets émis par chaque pays pourraient être brûlés par milliers : ils seraient rendus inutiles par les crypto-monnaies (telles que le Bitcoin ou l’Ether chez Ethereum) qui sont dès à présent stockées dans le « cloud » et cotées en Bourse sur des places monétaires bien réelles. Mais ce n’est pas encore pour demain. De premiers tests sont actuellement lancés pour vérifier la fiabilité du système.
La blockchain sécurise les paiements et les données
L’idée de la blockchain est séduisante, et ne se limite pas à un échange monétaire. Prenons un exemple : Claire a réalisé une étude sur les abeilles que Craig souhaite acheter pour 200 bitcoins. Tous deux s’étendent sur les termes de l’échange : Craig donne l’ordre de transférer 200 bitcoins de son compte à celui de Claire, via la blockchain, et de son côté Claire envoie son livre numérique à Craig, également par la blockchain.
Voici ce qui se passe alors. Lorsque Craig valide son ordre de transfert de bitcoins, celui-ci est enregistré sur le réseau de façon détaillée : nom de l’émetteur (ou plus précisément son pseudonyme d’utilisateur), le pseudonyme du destinataire, date et heure, montant transféré sont répertoriés au sein d’un bloc virtuel, qui va accueillir plusieurs autres ordres semblables. Ensuite, le bloc est adressé à différents « nœuds de réseaux » à travers le monde. Ces nœuds de réseaux (ou « mineurs ») sont des ordinateurs ou des téléphones portables identifiés au sein de la blockchain comme étant des certificateurs des ordres transmis. Plusieurs de ces nœuds vont accueillir le bloc, enregistrer les différentes transactions détaillées qu’il contient, et les comparer entre eux pour garantir l’authenticité de chaque ordre et le rendre disponible à l’ensemble des utilisateurs de la blockchain. Une fois inscrit dans ce « grand livre comptable » virtuel, la transaction ne peut plus être modifiée, ni effacée. Elle est conservée en mémoire jusqu’à la fin du monde… ou du moins jusqu’à la disparition de la technologie blockchain. Ainsi certifiée, ce qui prend aujourd’hui de 10 à 15 minutes, la transaction est réellement opérée, et les 200 bitcoins sont soustraits du compte de Craig et additionnés à celui de Claire.
Quand Claire envoie son livre numérique à Craig via la blockchain, tout se passe de la même façon : le pseudonyme de l’émetteur, celui du destinataire, la date et l’heure d’envoi, ainsi que l’exhaustivité du contenu sont enregistrés définitivement dans la blockchain après avoir été validés par les « mineurs ». Ainsi, quand Craig revendra ce livre numérique à François via la blockchain quelques mois plus tard, les « mineurs » reconnaîtront le texte et se « souviendront » des données de la transaction initiale. Chaque utilisateur ayant accès à l’ensemble des transactions répertoriées dans la blockchain, Claire sera en permanence identifiée comme le diffuseur initial, et donc l’auteur du document, quel que soit le nombre de transactions effectuées au fil du temps.
La blockchain permet donc de garantir la propriété intellectuelle d’une chanson, d’un tableau, d’un livre, d’un film et de tout document ou format numériques. Mais aussi de certifier la provenance d’un poisson ou la date de production d’un médicament. De même, pour la vente d’une voiture ou d’un appartement, la blockchain permettra à l’acheteur de connaître l’historique complet des précédentes transactions concernant ce bien.
La blockchain n’oublie jamais
La mémorisation « éternelle » et infalsifiable des données peut être conservée dans une blockchain « privée », accessible seulement à ses membres, tout aussi bien que dans une vaste blockchain publique, consultable librement. Cette blockchain ouverte à tous pourrait ainsi rendre inutiles les nécessaires démarches actuelles pour certifier l’authenticité d’un bien et enregistrer officiellement le changement de propriété lors d’une vente immobilière. Pour autant, n’enterrons les notaires trop vite !
Depuis son apparition en 2009, la blockchain n’a été utilisée que par des experts curieux et des férus de crypto-monnaies. Le fonctionnement du système à grande échelle doit encore être prouvé. Actuellement, la blockchain « bitcoin » peut opérer théoriquement 7 transactions par seconde au maximum alors que, dans le même temps, Paypal en traite en moyenne 155 et Visa, via son réseau VisaNet, en réalise 2000. L’expert technique du Bitcoin Nicolas Dorier estime que ce frein pourra à terme être levé par le « Lightning Network », une technologie complémentaire au Bitcoin, actuellement en développement, et qui ambitionne d’opérer des millions de transactions par seconde, quasi instantanément et à moindres frais. La blockchain « Ethereum » espère atteindre des performances équivalentes avec une technologie rivale, « Raiden Network ». D’autres nouveaux acteurs de la blockchain pourraient encore apparaître : en Chine, Qtum Project a ainsi annoncé en janvier avoir levé 1 million de dollars pour créer une blockchain chinoise qui mêlera les deux technologies déjà existantes.
Son impact sur l’ensemble de l’économie est inconnu
Outre la capacité de gérer de grands volumes d’ordre se pose l’enjeu de la consommation énergétique liée au « minage » des crypto-monnaies. Surtout, le défi majeur concerne la sécurité des utilisateurs de la blockchain. Jusqu’à présent, les piratages constatés n’ont visé que les fonds gérant les crypto-monnaies, et la blockchain elle-même reste vierge de toute corruption.
Mais avec son essor, de nouvelles problématiques émergent : si un litige survient entre deux utilisateurs, quel sera le droit applicable ? Et quelles sont les conséquences économiques de cette technologie sans régulateur ni intermédiaire ? En réduisant les coûts de contrôle des opérations au sein des banques d’investissement, la blockchain pourrait leur permettre d’économiser en moyenne 10 milliards de dollars par an d’ici à 2025, selon le cabinet Accenture. Qu’en sera-t-il dans les autres secteurs de l’économie ? Quelles seront les conséquences pour l’emploi ?
Pour tenter d’obtenir des éléments de réponses, des initiatives sont lancées partout dans le monde. En France, la Banque de France a lancé une expérimentation en juillet dernier avec plusieurs grandes banques, la Caisse des Dépôts et Consignations et des start-ups de la blockchain. Elle vient de renforcer ce dispositif avec l’annonce en janvier de la création d’un « Lab » pour multiplier ses collaborations avec les start-ups.
– Perrine Créquy

